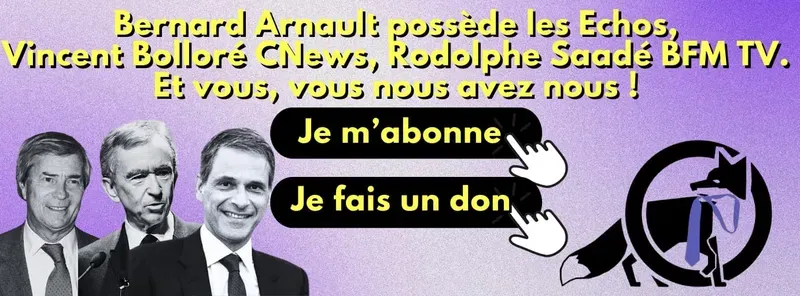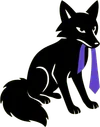270 milliards d’aides aux entreprises : le jackpot permanent (payé par nous tous)

Chaque année, l’État arrose les entreprises de centaines de milliards d’euros d’aides publiques. Officiellement, c’est pour l’emploi, la compétitivité, la recherche et l’innovation. En réalité, personne ne sait combien d’argent part exactement, ni ce qu’il devient. Les chiffres gonflent d’année en année : 160 milliards annuels, puis 211, aujourd’hui 270, soit plus que le total des dépenses publiques de santé. Pendant que les services publics sont étranglés, que les chômeurs voient leurs droits rabotés, et qu’on nous prend la tête avec la dette publique, les actionnaires encaissent sans condition ni contrôle. La sortie du livre Le grand détournement est l’occasion de refaire le point sur cette gabegie incontrôlable, dont nous payons tous le prix.
270 milliards d’euros d’aides publiques versées chaque année aux entreprises. C’est le nouveau chiffre qui circule médiatiquement, après les 211 milliards du rapport du Sénat d’il y a quelques mois. Il y a deux ans on parlait plutôt de 160 milliards. Va-t-on finir l’année à 300 milliards ? Si ce chiffre grossit sans cesse, c’est d’une part parce que les aides augmentent -elles ont été multipliées par 10 en trente ans-, mais aussi parce que l’État ne suit pas lui-même ces dépenses et qu’il faut donc des économistes, des politiciens et des journalistes pour tenter une estimation. Et à chaque fois on en oublie dans les coins. Comme le racontent les journalistes Matthieu Aron et Caroline Michel-Aguirre dans leur livre Le grand détournement, à l’origine du calcul des 270 milliards, les hauts fonctionnaires du Ministère des Finances s’y emmêlent eux-mêmes les pinceaux. « Les aides aux entreprises résultent de l’empilement des mesures prises à différentes périodes, avec des modes opératoires différents. Il est très difficile d’avoir une vision d’ensemble », indique par exemple la directrice adjointe de la direction générale du Trésor Claire Cheremetinski. « La lisibilité de l’ensemble est médiocre » confirme Louis Gallois, l’inventeur du CICE, ce crédit d’impôt de 20 milliards par an offert aux entreprises par Hollande sans aucune condition.
Comme le souligne le rapport du Sénat, au total plus de 2 200 dispositifs d’aide distincts existent, répartis entre l’État, les collectivités et les agences comme Bpifrance (le rapport ne prend pas en compte les aides européennes, contrairement à l’ouvrage Le grand détournement). « Il n’existe pas en droit interne de définition juridique transversale des aides publiques aux entreprises, ni de leur périmètre d’un point de vue économique. En outre, l’Insee ne dispose pas de données ventilées sur l’ensemble des aides publiques aux entreprises. En effet, les comptes de la Nation établis par l’Insee ne distinguent que deux lignes, les subventions sur la production et les aides à l’investissement, alors que les données sur les prélèvements obligatoires sont très détaillées. Aucun tableau de bord ne permet de connaître le montant des aides publiques octroyées aux grandes entreprises, car les obligations de transparence en vigueur sont parcellaires, de portée limitée et peu opérationnelles », pointe le rapport du Sénat. Quand Vincent Aussilloux, directeur du département Economie de France Stratégie (organisme public français, directement rattaché au Premier ministre), a voulu faire ses calculs, il a été stupéfait : il en a trouvé 223 Milliards « Je ne m’attendais pas à un tel chiffre (…) La France est le pays d’Europe qui soutient le plus massivement ses entreprises », affirme-t-il aux auteurs du grand détournement. En 1990, le montant n’était que de 30 milliards d’euros par an. En 1980, c’était 10 milliards annuels.
C’est nous qui payons ces milliards pour les entreprises
Les plus gros dispositifs d’aides publiques sont ceux qui réduisent les cotisations patronales payées par les entreprises. C’est le cas de la réduction Fillon, mise en place sous Nicolas Sarkozy, qui réduit les cotisations patronales des salaires payés entre 1 et 1,6 SMIC. Vient ensuite une nouvelle baisse pérenne de cotisations sociales, mise en place en 2019 en remplacement du CICE (un dispositif mis en place sous Hollande et reconduit sous Macron en 2019 sous la forme d’une exonération de cotisations patronales pour le même montant, 20 milliards par an) qui exonère partiellement de cotisations patronales les salaires jusqu’à 2,5 SMIC. Or, ces exonérations, qui représentent une perte sèche pour la Sécurité sociale, sont compensées par l’État, qui paye à la place des entreprises exonérées. Nous payons donc notre modèle social deux fois, par nos cotisations assises sur nos salaires et par nos impôts qui viennent compenser les cotisations sociales que les entreprises ne versent pas. Ensuite, il y a des crédits d’impôts comme le Crédit d’impôt recherche (CIR), mis en place dans les années 1980 puis sans cesse étendu et simplifié, qui donne des crédits d’impôt aux entreprises qui déclarent des dépenses de recherche et développement (quelles qu’elles soient) et le Pacte de responsabilité, un ensemble d’exonérations votées sous la présidence de François Hollande. Chaque gouvernement, depuis le début des années 2000, a ajouté des dizaines de milliards d’euros transférés de nos poches vers les entreprises.

Ces aides ne sont pas évaluées, pas suivies dans le temps, pas conditionnées. Un système opaque et une dispersion qui nourrit l’illusion qu’il ne s’agirait pas d’un système cohérent. Or il l’est : c’est celui de la captation de la richesse publique par les intérêts privés. Pendant qu’on coupe dans les services publics, qu’on réforme l’assurance chômage et qu’on serre la vis aux minima sociaux, l’État organise la redistribution à l’envers. L’argent versé sans conditions alimente les profits, les délocalisations, et les plans de licenciements massifs. Le capitalisme n’est donc pas ce qu’on nous raconte. On nous dit que dans notre pays, il y aurait d’un côté les « entrepreneurs » du secteur privé qui ne comptent pas leurs heures pour « créer des richesses » et des emplois, ne devant leurs revenus qu’à la force de leur travail, et de l’autre les fonctionnaires, fardeau budgétaire terrible pour la société, qui ne produisent rien d’autre que du service public déficitaire et peu performant. D’un côté un apport, de l’autre un coût. Or, rien n’est plus faux : désormais, le secteur privé coûte au contribuable bien plus cher que nombre de services publics. 270 milliards d’euros d’aides publiques aux entreprises, c’est largement plus que la totalité des dépenses publiques consacrées à la santé qui s’établissent à 249 milliards d’euros.
Des effets inexistants sur l’emploi
Tous les ministres de l’Économie répètent la formule magique suivante : en aidant nos entreprises, en subventionnant leurs coûts salariaux, on leur permet de restaurer leur compétitivité et de créer de l’emploi, et c’est ça que l’on veut non ? Sauf que ça ne marche pas. Toutes les études, y compris ministérielles, sur les effets de ces milliards dépensés pour les entreprises privées, montrent que les effets sont faibles voire inexistants. Le dernier rapport en date, celui de l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES), le principal institut de recherches syndicales en France, n’y va pas par quatre chemins : « L’efficacité des allègements du coût du travail se trouve sans doute ailleurs : dans le soutien apporté aux marges des entreprises », nous dit-il… et ces marges, les entreprises en font bien ce qu’elles veulent. Et ça n’a pas servi à créer de l’emploi, ni à relocaliser notre industrie, mais bien à augmenter les dividendes des actionnaires.
Et on appelle cela « l’économie de marché », « la loi du marché », « le capitalisme globalisé » ? Faire transiter des milliards d’euros du public au privé par intervention étatique semble a priori contraire à la doctrine de non-intervention étatique prônée par le libéralisme économique. Mais en réalité, la doctrine néolibérale n’a jamais prôné la fin des transferts vers le privé, au contraire. Ce que ses partisans souhaitent, c’est que l’État ne se mêle pas du fonctionnement des entreprises, c’est tout. Mais son argent est le bienvenu. C’est pourquoi, tandis qu’il enrichit les entreprises privées et ses actionnaires, l’État réduit la régulation du droit du travail en leur sein, leur offre des marges de manœuvre plus grandes, ouvre de nouveaux marchés… Le néolibéralisme n’est pas la non-intervention de l’État. C’est une intervention massive de l’État pour aider le capitalisme à fonctionner mieux et plus fort. C’est un État-providence, un État-parent pour les entreprises, le patronat et les actionnaires. Car malgré ces milliards d’euros injectés dans l’économie, nous ne sommes pas dans une économie socialiste ou administrée, comme aiment se le raconter quelques éditorialistes croulants du Figaro pour se faire peur à peu de frais. Pas du tout : l’État dépense quasiment la moitié de son budget pour les entreprises privées, mais ne cherche à obtenir aucun contrôle sur elles.
L’entrepreneuriat qu’on érige en héroïsme individualiste et audacieux n’est autre, dans notre pays, que l’art de gratter tous les dispositifs d’aide publique possible, tout en mordant dès que l’on peut la main que l’on nous tend. En bon serviteur des possédants, le gouvernement trouve toujours de nouvelles mannes à distribuer aux entreprises sans contrepartie. La vraie « rue des allocs », du nom de cette émission britannique au concept dégueulasse – filmer la vie de supposés « assistés » – et importée par M6 en 2016, se trouve à la Défense : ceux qui prennent le plus d’argent public, le dépensent sans le moindre contrôle et n’arrivent plus à vivre sans, ce sont les patrons du CAC 40. Pour sortir de cet enfer, le mouvement social actuel pourrait poser une exigence simple : supprimer toutes les aides publiques qui ne sont pas strictement vitales à la survie financière des entreprises. Et pour celles qui le sont, imposer un retour réel, tangible, collectif. Car pourquoi l’argent public ne donnerait-il aucun pouvoir en échange ? Quand l’État investit des millions dans une entreprise, il doit entrer au capital. Et mieux encore : une partie de ces aides pourrait être transformée en actions sociales (c’est-à-dire non lucratives) détenues par les salariés, sans dividende, sans revente possible, mais avec des droits de vote en conseil d’administration. Ce serait une reprise de contrôle légitime par celles et ceux qui produisent les richesses et qui, en plus, paient pour les profits des autres avec leurs impôts.
Guillaume Etiévant et Nicolas Framont
Photos de couverture de Jp Valery sur Unsplash
Rédaction