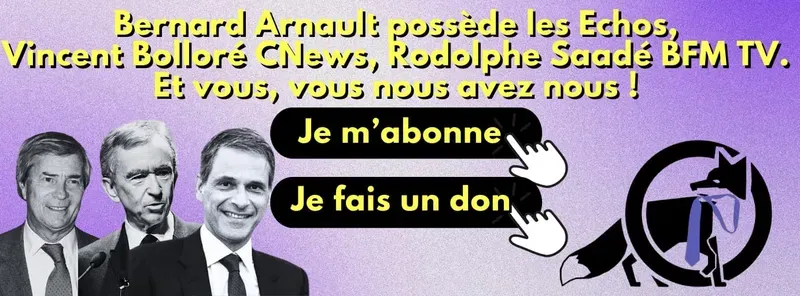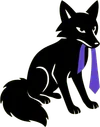Burn-out en prime time : l’aliénation des cadres dans les séries françaises

La récente sortie de la troisième saison d’Hippocrate sur Canal + met en lumière une récurrence dans les séries françaises à succès : celle de filmer le travail, et même plus spécifiquement le rapport de dépendance et d’aliénation qu’il entretient avec ses personnages. Alors que les différents gouvernements successifs semblent toujours plus obnubilés par l’idée de faire travailler plus et plus longtemps les Français·es, on peut trouver la relation troublante : l’obsession pour le travail a franchi le pas de porte des salarié·es pour venir s’installer dans les salons quotidiennement.
Une souffrance de classe
Dix pour cent, Le Bureau des légendes, Hippocrate : trois productions made in France dont le succès tant critique que public a marqué l’univers des séries au cours des dix dernières années. D’imprésarios de stars débordé·es à agents clandestins pour la DGSE sur les dents en passant par internes à l’hôpital toujours plus sollicité·es, force est de constater qu’on retrouve une analogie dans les trois productions : toutes se déroulent en grande majorité sur le lieu de travail de travailleur·ses dont la santé mentale et la vie personnelle pâtissent de leur aliénation professionnelle. Autant mettre les pieds dans le plat dès maintenant : les emplois exercés par les personnages présentant un rapport d’aliénation sont, pour la majorité, des professions associées à la classe sociale des dominant·es.Tous·tes (à l’exception des internes dans les saisons une et deux d’Hippocrate) occupent à des échelles différentes un poste à responsabilité qui induit une rémunération supérieure au salaire médian et une reconnaissance sociale forte ; bref des cadres supérieurs, fortement diplômés. Et même plus généralement, ces personnages ont tous suivi des études leur ayant permis de choisir un emploi valorisant et gratifiant selon leurs critères : un boulot qu’ils aiment.
« J’aime mon travail, j’ai pas envie de m’arrêter ! »
Au premier abord, on s’inquièterait moins de la pénibilité au travail d’agents de stars du cinéma évoluant dans des bureaux climatisés du 1er arrondissement de Paris que d’ouvrier·ères de nuit précarisé·es. Pour autant, ces récits de personnages s’accordent avec une forme de réorientation des objets d’études de la sociologie : s’intéresser aux répercussions du travail sur l’état de santé physique et mental des employé·es du tertiaire. Cette réorientation est évidemment la conséquence d’un changement structurel du monde du travail depuis la fin des années 1960, ayant abouti à une importante tertiarisation des emplois jusqu’aujourd’hui. Dans leurs travaux respectifs, Christophe Dejours et Danièle Linhart expliquent que, pendant longtemps, la prise en considération de la souffrance au travail ne s’appliquait qu’aux ouvrier·ères et aux classes laborieuses.

Seulement, en mettant au centre de son fonctionnement le « bonheur au travail », le management moderne est entré à grande vitesse dans la vie de ses employé·es, allant même parfois jusqu’à les en déposséder et entraînant un nombre important de phénomènes de surmenage et de burn-out. Et ce surmenage est parfaitement illustré dans une scène de l’épisode 1 de la saison 3 de Dix pour cent. Le personnage d’Andréa (joué par Camille Cottin), enceinte, subit une contraction douloureuse dans les bureaux de l’agence ASK. Les autres imprésarios l’intiment de prendre son congé maternité le plus rapidement possible, le personnage de Mathias lui rappelant même qu’elle n’est « pas obligée de toujours jouer aux Wonder Woman non plus ». À la suite d’un débat agité elle finit par s’énerver : « Mais putain mais j’aime mon travail, j’ai pas envie de m’arrêter ! Si je m’arrête je perds un tiers de mon fichier ! » Et c’est justement cet aspect que ces séries françaises parviennent à mettre en lumière, le rapport d’assujettissement instauré par les transformations néolibérales du travail. Encore plus insidieuse que l’aliénation décrite par la théorie marxiste, celle-ci inclut une prétendue autonomisation au travail dans laquelle les salarié·es sont constamment encouragé·es à anticiper les problèmes et à faire preuve d’initiative. Elle s’incarne aussi dans la transformation numérique qui brouille la frontière entre vie professionnelle et vie privée, rendant toute déconnexion impossible et favorisant le surmenage. Les exemples de dépendance dysfonctionnelle sont nombreux dans ces trois productions : les médecins de l’hôpital enchainent les gardes et les heures sups non-payées à cause du manque de personnel, le personnage d’Andréa dans Dix pour cent accepte des rendez-vous professionnels en soirée afin de pouvoir assister à la pré-rentrée de sa fille et le directeur du Bureau des Légendes (campé par Jean-Pierre Daroussin) arrive au travail avant 7 heures prétendant que : « Ça sert à rien d’essayer de dormir, dès que je ferme les yeux, je rêve d’agents doubles ».
Le travail : un objet visuel déformé
Filmer le rapport au travail en France n’est pas l’apanage des séries contemporaines, on pourrait même qualifier cette pratique de tradition ayant commencé avec le tout premier film français et même – les avis divergent – de l’Histoire du cinéma : La Sortie des usines Lumière à Lyon (1895) de Louis Lumière, plan-séquence fixe de 45 secondes dans lequel ouvriers et ouvrières de l’usine Lumière, industrie photographique détenue par les frères du même nom, quittent l’usine à la fin d’une journée de travail. Depuis 1895, une importante filmographie documentaire et fictionnelle du travail s’est constituée, incarnée notamment aujourd’hui par des films à valeur sociale comme l’œuvre de Stéphane Brizé ou la récente sortie de La Syndicaliste avec Isabelle Huppert. Pourtant, ces films semblent s’attacher à représenter la trajectoire individuelle d’un·e travailleur·se et à embarquer les spectateur·ices dans une histoire dont les contraintes narratives freinent la possibilité d’une mise en scène quotidienne du travail. Le cinéma de fiction, du fait de son industrie et de ses besoins narratifs, a souvent tendance à s’attarder sur des caractéristiques très précises du travail dans le but d’en montrer sa pénibilité. Mais rares sont les films qui réussissent à représenter le monde du travail convenablement, c’est à dire également dans ses aspects ordinaires. On en arriverait donc à se demander, comme l’affirme l’historienne du cinéma Monique Peyrière, si ce qui réside dans le travail ne finit pas par « échapper au cinéma ».
Collègues au bureau et collègues à l’écran
À l’inverse, le caractère régulier (voire quotidien) des séries instaure une routine qu’on peut rapprocher de celle de la vie professionnelle : on retrouve ses collègues télévisé·es le soir comme on rejoint ceux du bureau le matin. Les séries s’attachent à représenter les interactions sociales et les pratiques qu’engendre le monde professionnel : le café du matin, le rapport brutal qu’implique la hiérarchie, les habitudes des collègues, l’intégration des nouveaux, la progression professionnelle. Beaucoup de ressorts narratifs et comiques des séries en question reposent d’ailleurs sur ces pratiques. Le personnage d’Arben Bacha interprété par Karim Leklou dans Hipprocrate est accro aux brioches Pitch dont le tiroir de son bureau regorge et le directeur du fameux Bureau des légendes Henri Duflot a un goût prononcé pour les cravates fantaisistes : des caractéristiques communes à tous les secteurs d’activité (qui n’a jamais raillé la nouvelle chemise de son RH à la machine à café ?).
Travail fictif, souffrance réelle
Mais pourquoi accueillir chez soi un cadre de travail fictif quand on vient de passer la journée dans un environnement qui nous apparaît parfois comme un peu trop réel ?

Quelle satisfaction peut-on trouver en faisant ressurgir le vendredi soir une partie des souffrances de la semaine autour d’un plateau repas ? En réalité le succès des séries évoquées est ailleurs, il réside dans le fait qu’elles mettent en avant les coulisses des professions fictionnalisées, des métiers qui de surcroît peuvent être considérés comme atypiques (agent secret, imprésario de stars, médecin à l’hôpital). Mais aussi atypiques que soient ces professions, les dynamiques quotidiennes qui leurs sont liées sont en mesure de résonner chez l’ensemble des spectateur·ices qui vivent une partie de ces réalités au travail. Comme l’explique le philosophe Thibaut de Saint Maurice :
« Je n’ai jamais travaillé dans un service de renseignement donc la nature de leur travail est nouvelle pour moi. Néanmoins, je vois qu’ils alternent des phases d’analyse et de travail individuel, puis de mise en commun dans des réunions, des discussions à la cantine et des tensions avec leur hiérarchie. Ça, ce sont les choses qui ressemblent à ce que je peux voir dans mon travail. C’est-à-dire qu’il y a une sorte d’analogie de situation qui fait que l’on peut partager ce regard sur ce qui constitue l’ordinaire de leur travail. »
Une partie de l’enjeu des séries est là ; montrer l’ordinaire de la souffrance au travail et permettre aux spectateur·ices « de prendre de la distance et de retrouver une forme de maîtrise de ce que nous vivons parfois comme une contrainte ». (Thibaut de Saint Maurice) Et c’est peut-être au contraire ce qui rend le travail tertiaire si difficile à filmer par le cinéma social, lorsque vie privée et professionnelle s’entremêlent et que la souffrance mentale et psychique n’est plus aussi palpable que la souffrance physique. On pourrait renchérir en disant qu’il ne s’agit pas d’une spécificité nationale et que les productions américaines ne sont pas en reste sur la question du monde du travail (de The Office à Grey’s Anatomy en passant Parks and Recreation). Mais en réalité la vocation de ces sitcoms ou de ces soaps semblent plutôt d’adapter les codes du travail et d’en grossir les traits dans une vocation humoristique ou romantique (la résistance à toute épreuve du brushing de Derek Shepard, iconique symbole d’un monde professionnel fantasmé).
Frontières du travail et de la fiction brouillées
Dans Le travail et ses dehors. Porosité des temps, pluralité des vies, le sociologue Norbert Amsellem avance que le néolibéralisme a contribué à brouiller les frontières entre le temps de travail effectif et les « loisirs », les rendant de plus en plus poreuses. Il explique que la surprésence du travail dans le quotidien entraîne des cas de « surinvestissement » qui empêchent les salarié·es de se consacrer à des activités entièrement extérieures à sa profession. Le travail polarisant donc le temps du « dehors » et réduisant continuellement les individus à leur seule fonction de travailleur·ses. C’est alors que le rapport métafictionnel s’instaure, car la série française perd de son intérêt lorsque, comme son personnage, elle tente de s’extraire de la sphère professionnelle pour revenir à la sphère privée, pour représenter les « dehors » ; comme si elle était, elle aussi, polarisée par le cadre professionnel. Dans Hippocrate, le personnage d’Alyson Lévêque (interprété par Alice Belaïdi), interne à l’hôpital, est aussi construit à travers sa relation avec son petit-ami Samir, extérieur au monde de la santé et très préoccupé par la dépendance de sa compagne à son travail. Lorsque le scénario tente de s’éloigner de la question du rapport des personnages au travail (intimité, conflits au sujet de la recherche d’un appartement) Hippocrate perd de son souffle romanesque et le scénario reconduit d’ailleurs rapidement le personnage d’Alyson sur le lieu de l’hôpital. De même dans Le Bureau des légendes, les interactions sociales privées des personnages, hors du bureau du boulevard Mortier (siège de la DGSE), sont franchement en dessous du reste de la série. Comme si diégèse et constats sociologiques fusionnaient pour pointer du doigt l’aliénation des soignant·es de l’hôpital public français ou des agent·es de la DGSE. Comme si le travail ne devait être que le seul et unique paramètre à prendre en compte, sacrifiant toutes les autres sources d’émancipation.
Une dépolitisation qui questionne
Aucune de ces trois séries n’aborde pour autant frontalement la question politique de l’aliénation au travail, contrairement peut-être à ce qu’en a fait le cinéma. Si Hippocrate réussit assez brillamment à figurer l’État comme seul et unique antagoniste de la série, laissant à l’abandon un hôpital public au bord de l’effondrement, ni la question des salaires ni celle des retraites ne sont réellement traitées dans les trois productions. De plus, les rapports de genre et de race au travail ne sont aussi que très peu soulevés. On note quand même que le personnage d’Andréa joué par Camille Cottin s’est vu refuser un poste en raison de sa maternité dans la saison 3. Elle déclare d’ailleurs à ce propos aux prémices de la saison 4 : « Je suis DG, mère de famille et agent ». La question du surmenage est également brièvement traitée dans Dix pour cent, le personnage de Gabriel étant sujet à un burn-out (burn-out s’étalant sur deux épisodes). Sans forcément tirer des conclusions sur le faible traitement politique du travail dans ces séries, il reste utile de garder en tête que, pour le cas du Bureau des légendes et d’Hippocrate, les deux productions ont été diffusées sur Canal +, la chaîne cryptée préférée des urbains socio-démocrates à revenus supérieurs et propriété du milliardaire Vincent Bolloré. Force est de constater que la représentation de cadres sups du tertiaire s’avère plus fidèle lorsqu’ils sont interprétés par des acteur·ices – appartenant eux-même à la bourgeoisie – que quand ces dernier·es se mettent dans la peau d’ouvrier·ères ou des leadeur·euses syndicaux.
Par ailleurs, même si ces trois séries réussissent assez bien à mettre en lumière une nouvelle forme d’aliénation au travail, cette dépolitisation évoquée interroge sur le discours véhiculé par ces productions. En centrant leur dramaturgie sur la relation à la fois addictive et toxique qu’entretiennent les personnages avec leur milieu professionnel, ces trois séries participent d’une certaine manière à alimenter une vision valorisante de l’hyperinvestissement au travail, dans laquelle l’identité semble conditionnée au dévouement professionnel et à l’utilité sociale. En creux, c’est le message implicite du « travailler vous rendra fou, mais vous serez un fou aussi valeureux qu’admirable » qui se dessine. Si quelques personnages secondaires incarnent des figures de mise en garde, semblant percevoir avec lucidité la relation destructrice qu’entretiennent les protagonistes avec leur métier – là où ces dernier·ères y étaient resté·es aveugles – (Colette, la compagne d’Andréa dans Dix pour cent, le Docteur Balmes, psychiatre dans la saison 1 du Bureau des Légendes, ou encore Manuel Simoni, médecin et compagnon du personnage joué par Louise Bourgoin dans Hippocrate), ces rares voix critiques sont souvent présentées ou perçues comme des figures castratrices, freinant l’accomplissement professionnel et empêchant une forme de dévotion totale, voire de vocation au travail.
En érigeant des personnages addicts au travail en héros au destin tragique, souvent romanesque et (spoiler alert) parfois mortel, on peut légitimement s’interroger sur la manière dont ces fictions contribuent, insidieusement, à glorifier une forme moderne de surinvestissement professionnel.
Jules Adam Mendras