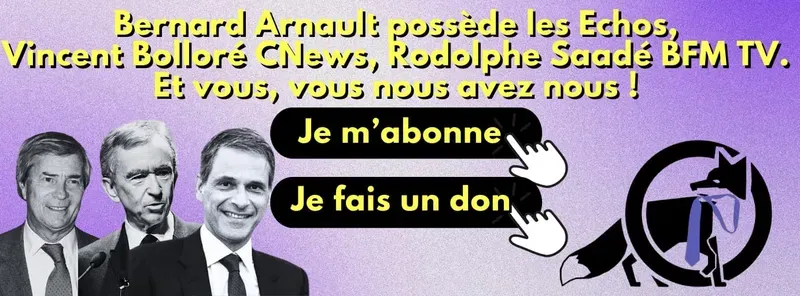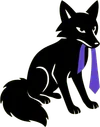Fatima Ouassak : “Depuis les gilets jaunes, je passe mon temps à dire “mais si, il y a moyen de lutter ensemble !”, et je vois que ça marche”, Deuxième partie
Pour Fatima Ouassak, la cofondatrice du “Front des mères” (premier syndicat de parents d’élèves des quartiers populaires), le lieu de notre rencontre pour réaliser cet entretien semble être une évidence. Il s’agit de la petite ville de Bagnolet où elle réside dans le 93 en région parisienne, un territoire de luttes historiques et d’immigration composé d’avenues et de places au noms de révolutionnaires passés : Marx, Angela Davis… La place Nelson Mandela, où nous nous retrouvons dans un café, se révèle être le lieu de rencontre des bagnoletais pour “refaire le monde” et le “bilan d’une grève”, sans oublier de déjouer les “traquenards de périodes électorales”… Le premier ouvrage de Fatima, La Puissance des mères : Pour un nouveau sujet révolutionnaire, l’un des livres les plus enthousiasmants et percutants de cette rentrée, s’inscrit pleinement dans cette dynamique historique et militante. En partant de son expérience personnelle de mère aujourd’hui de deux enfants, elle raconte les luttes collectives victorieuses, les discriminations systémiques de l’Etat et du capitalisme subies, ou encore comment l’on a cherché à gentrifier et à récupérer leurs combats. Son livre se révèle être un véritable manifeste, celui des mères comme sujet politique à part entière au service des enfants présents et de demain, et contre toutes les oppressions de l’ordre social établi. Rencontre, par Selim Derkaoui et Nicolas Framont.
Les initiatives comme “Ma cité va briller” avec des jeunes de quartiers qui doivent ramasser les déchets, tu en penses quoi ?
Je n’en peux plus ! L’année écoulée, comme j’étais beaucoup invitée sur des trucs écolos, on me disait « regardez ce qu’on a mis en place, c’est merveilleux : le clean challenge ». Quand ce sont des gens des quartiers qui le font, je sais que c’est sincère, ça me va. Mais le fait que ce type de projet se soit multiplié, parce qu’il est subventionné par des collectivités et boosté par des organisations politiques, là ça me pose problème. La question c’est : pourquoi ça se fait autant et que les pouvoirs publics soutiennent ? Pourquoi c’est devenu LE truc écolo des quartiers populaires ?
Dans le cadre de leur campagne électorale aux dernières municipales, des gens qui se présentaient comme écologistes et qui habitaient quasiment tous le quartier des Coutures (quartier le plus pavillonnaire de la ville) ont débarqué dans le quartier de la Capsulerie, en face du métro Gallieni – là où il y a toutes les barres et le plus vieux foyer Sonacotra du 93 (Société nationale de construction de logements pour les travailleurs, anciennement Société nationale de construction de logements pour les travailleurs algériens). Un endroit où ils n’ont pas l’habitude d’aller étant donnée leur sociabilité. Ils ont débarqué avec leur gilet vert, dans le cadre d’un projet « clean challenge », et ont dit « allez, les mamans, et les enfants, venez, on va nettoyer le quartier ». C’est vrai que c’est un quartier sale, et ils disaient : « ça, c’est de l’écologie populaire ». Ils demandent aux gens de nettoyer, mais ne demandent pas un service public égalitaire. Dans leur programme aux municipales, il n’y avait rien pour dire “ce n’est pas normal que tel quartier, parce qu’habité par des CSP+, soit parfaitement entretenu par les pouvoirs publics, et que tel autre, parce qu’habité par la classe populaire, soit si peu entretenu et nettoyé”. C’est bien un problème politique pourtant. Ce n’est pas aux gens des quartiers, qui payent des impôts aussi, de nettoyer eux-mêmes !
Ces projets « clean-challenge » participent d’une écologie coloniale, de gentrificateurs qui viennent dans les quartiers avec des représentations racistes et hygiénistes. Une écologie de classe qui ne pose pas la question de l’égalité.
C’est le problème de ces opérations « clean challenge » dans les quartiers : il n’y a pas de remise en question des inégalités en termes de service public, avec aussi un propos extrêmement hygiéniste, sur la nécessité d’être propre, et ce préjugé selon lequel les noirs et les arabes ne sont pas propres, qu’il faut leur apprendre à l’être. Une conception de l’écologie pour le moins bas de plafond. Ce qu’on a envie de leur demander surtout, c’est « comment vous osez demander à nos enfants d’aller nettoyer ? Vos enfants à vous, ils n’ont pas à nettoyer leur quartier ! ». En plus c’est conditionné : souvent ces projets sont gérés par des centres sociaux, et parce que tu vas nettoyer tu vas pouvoir partir à la plage, à Deauville, etc. Alors que les autres enfants n’ont pas besoin de nettoyer pour partir en vacances ! Il faut travailler pour mériter – aux yeux de la collectivité – de partir en vacances.
Ceci n’est pas nouveau. Dans les quartiers populaires, on conditionne la citoyenneté à l’effort d’intégration. Dès les années 1980-90, il y avait les projets ski, où on conditionnait le fait de partir à plein d’activités : tu devais vendre des trucs, faire du porte à porte, alors que tu as 12 ans, tu n’es pas sensé travailler ..! C’est pourquoi je trouve que ces projets clean-challenge participent d’une écologie coloniale, de gentrificateurs qui viennent dans les quartiers avec des représentations racistes et hygiénistes. Une écologie de classe qui ne pose pas la question de l’égalité. On pourrait avoir un programme écologiste qui porte sur la ségrégation socio-spatiale et les inégalités d’accès aux services publics, mais ces questions ne sont jamais abordées.
Les gens de gauche seraient les pires pour les quartiers populaires car ils se parent de vertu, ce qui les rendrait encore plus violents ?
Je pense effectivement que mobiliser des valeurs de gauche et des enjeux nobles rend les manipulations électoralistes et les injonctions paradoxales encore plus redoutables. Qui est contre l’égalité femmes-hommes, qui est contre la laïcité ? Personne. Ces gens ne vont pas admettre qu’ils sont racistes, ou islamophobes, ils préfèrent dire qu’ils sont féministes ou universalistes… Mais maintenant grâce à tout le travail qu’on a fait sur l’islamophobie, c’est moins bien accepté. On voit bien qu’avec la marche contre l’islamophobie, une organisation comme la CGT est partagée, mais souvent c’est parce que ses dirigeants, comme Philippe Martinez, ne sont pas très formés sur ces questions.
Beaucoup de gens de gauche ne s’y intéressent tout simplement pas. Mais avec ce livre, je peux dire aux gens sincèrement naïfs sur le sujet “voilà en réalité à quelles fins est mobilisée l’étiquette « communautariste »”. Il faut discuter et échanger à gauche avec des gens qui peuvent avoir une sorte de déclic très rapidement et la compréhension de ce qu’on vit. Et puis dans le livre, je parle surtout des cadres de gauche, pas des militants. Or, les cadres politiques, ce sont des gens qui ont des intérêts précis, notamment l’argent. On en parle très peu mais il faut garder ça en tête : la politique permet de se faire de l’argent, quand on cumule des indemnités de maire, d’agglomération, d’administrateur, qu’on prend des commissions à droite, à gauche, etc. Il est plus facile de faire de la politique avec des militants de base qu’avec des cadres d’organisation, qui suivent leurs intérêts et peuvent parfois être guidés exclusivement par la cupidité, l’ivresse du pouvoir, ou tout autre chose.
Dans ton livre, tu dis qu’il faut transmettre à ses enfants une ambition et une envie de réussir, mais sans les pousser à la compétition ou à se conformer aux normes dominantes… Mais dans ce cas, comment opère t-on ?
J’utilise le terme “réussite” justement parce que je sais à quel point les parents – je précise, des quartiers populaires descendants de l’immigration – sont face à des dilemmes dès lors qu’il s’agit de la réussite. Et je tiens à ce terme “réussite”, parce que c’est déjà arrivé que des militants de gauche remettent en question ce terme employé par des femmes de quartiers populaires de Montreuil, lors d’une réunion publique. Ils leur disaient : “essayez d’utiliser un autre terme, car la réussite c’est le champ lexical du capitalisme, il faut le déconstruire”. Et moi j’étais intervenue pour dire “non non, je sais qui tu es, je sais que ton gosse a fait l’ENS ou je ne sais quoi”. Les gens qui déconstruisent le terme “réussite” préféreraient se couper un doigt plutôt que de scolariser leurs enfants dans l’école de secteur !
De base, quand on est immigré, on veut que ses enfants réussissent. Si nos parents ont quitté l’Afrique, c’est pour qu’on ait une vie meilleure qu’eux, qu’on réussisse. Il ne faut pas s’inventer une vie : moi je veux que mes enfants réussissent. Mais à partir du moment où on réussit scolairement, c’est souvent au détriment de sa confiance en soi, de sa dignité, de celle de ses parents, du rapport qu’on a à sa langue, à sa culture, à sa religion. Et ça je l’observe beaucoup autour de moi. Le dilemme c’est donc celui-ci : je veux que mon enfant réussisse, mais je ne veux pas que ce soit au détriment de sa dignité. Malgré ce qu’on peut entendre, les parents immigrés font souvent tout pour que leurs enfants s’en sortent à l’école. La preuve : à classe sociale égale, les enfants d’immigrés y réussissent mieux. Nous avons eu des parents qui nous disaient “travaille”, “ne te plains pas”, “le problème c’est toi, travaille encore plus”… Mon père me disait, quand j’avais 18/20, “où sont passés les deux points manquants ?” Ton père a travaillé à l’usine toute la nuit, ta mère est seule dans un tout petit appartement, où on est dix, donc c’est pas pour que tu ramènes 18/20, mais 20. Sinon, tu vas finir comme moi ! »
Je pense que c’est ce qui explique pourquoi le facteur immigration est en réalité un déterminant favorable à classe sociale égale. Je sais que si je dis aux parents “ce qui compte ce n’est pas la réussite”, ils ne me calculeront même pas. Ils diront – à juste titre, même si on n’a pas su ou voulu s’extraire de la classe populaire pour autant -, que j’ai fait Science po et que mon mari est prof. La réussite c’est important. Et d’ailleurs je reviens dans le livre sur un malentendu d’adultes enfants d’immigrés, qui ont eu à subir cette stratégie scolaire de la réussite à tout prix : je parle de la rancœur que peuvent avoir certains de ces adultes par rapport à leurs parents, leur reprochant d’avoir baissé la tête, de leur avoir dit de travailler deux fois plus que les autres… Je reviens là dessus pour dire “vous ne vous rendez pas compte à quel point ils avaient raison !”. Car la seule offre politique, à l’époque, c’était de suivre des stratégies individuelles, il n’y avait pas d‘organisation de parents. Et même au Front de mères on n’est pas encore de masse suffisante. L’école, c’est la guerre : elle isole les parents et c’est un système concurrentiel. Donc les parents de cette génération avaient raison de dire : “la priorité, c’est de vous extraire de la classe populaire”. Parce qu’un enfant arabe qu’on laisse dans la classe populaire, va subir mille fois plus de violence que les autres.
Notamment des violences policières ?
La dimension raciale n’explique pas à elle seule les violences policières. Un jeune homme arabe ne subira pas la même chose selon qu’il est livreur ou cadre supérieur, c’est évident. La classe sociale est déterminante. Après, bien sûr, c’est lié. Mais voilà, la priorité pour les parents c’est de dire “pour que tu ne subisses pas trop de violence, il faut tout faire pour que tu quittes la classe ouvrière”. Quitte, effectivement, à ce que tu ne dises rien quand on te dénigre, toi, ta religion, ta famille… prends sur toi, parce que derrière tu pourras être mieux, tu seras mieux respecté si tu as de l’argent. Le calcul est bon, a priori.
Mais pour moi, la réussite oui, mais pas au prix de notre santé mentale : ne pas être obligé de faire allégeance concernant notre religion, notre langue maternelle, nos luttes. Il faut donc transmettre notre culture, notre mémoire des luttes. Ca peut vraiment changer les individus et les faire gagner en confiance en soi. Et je dis aux parents “plus les enfants auront confiance en eux, mieux ils réussiront”. On en fera des individus qui ont un fort sens critique, qui croient en eux, qui ont une capacité à ne pas se résigner et à s’émanciper. Donc réussir à faire des enfants qui réussissent, mais critiques, ambitieux, curieux… Evidemment, c’est encore balbutiant comme projet, mais je pense que c’est la bonne voie. Déjà pour éviter de devoir dire à son enfant déjà discriminé qu’il doit en faire deux fois plus, il faut que nous, parents, on se batte plus pour nos enfants. C’est à nous collectivement de nous battre deux fois plus, pas à nos enfants. Par exemple, les parents ne se sont pas mobilisés contre Parcoursup.
A l’époque où le dispositif était en discussion, je savais que ce serait la guerre en Seine-Saint-Denis. Parcoursup, le système d’options et le bac territorialisé constituent un système extrêmement discriminatoire, avec des options qu’il n’y a pas dans nos collèges et lycées, et donc la concurrence et les inégalités s’accentuent. Et les collégiens et les lycéens l’ont bien compris. Quand tu regardes ton avenir, le sort qu’on te réserve, et que tu vois que ça va être la misère, tu veux agir, c’est normal. Mais les parents n’ont rien fait pour leurs enfants. Le mouvement lycéen qui a commencé en 2018 a compté beaucoup de lycéens qui vivent dans les quartiers populaires, et c’était contre Parcoursup.
C’était la première année où il fallait mettre les vœux pour les études supérieures. Et lors de cette première année, il y a un lycée de Pantin et un lycée à Bondy qui ont eu 100% de refus. Dès fin novembre – début décembre, quand le mouvement lycéen a rejoint le mouvement des gilets jaunes, il y avait ce dilemme, chez les parents : est-ce que je laisse mes ados aller manifester alors qu’ils risquent d’être mutilés ou est-ce que je les enferme à double tour ? Ce dilemme aurait pu être évité si nous adultes, parents, on avait fait le travail avant. C’est parce qu’on ne se mobilise pas assez que nos enfants sont obligés de descendre dans la rue, s’y retrouvant nez-à-nez face à la police.
Donc nous parents, et tous les parents, on doit se demander comment on se bat pour avoir un autre système scolaire pour que nos enfants soient à égalité et qu’ils puissent croire en leur avenir. Sur la Seine-Saint-Denis, les populations qui vivent dans les quartiers populaires sont très majoritaires, on représente une force politique potentielle immense. D’où cette accusation de communautarisme, car cette démographie inquiète. On est une “minorité politique” certes, mais démographiquement, on est là. Reste à s’organiser.
C’est justement pour cela qu’on cherche à diviser la classe populaire, entre les populations des banlieues et les gilets jaunes ?
Complètement. En 2018, au moment des gilets jaunes, il y a eu cette violence, notamment à l’égard des jeunes, mis à genoux à Mantes-la-Jolie. C’était justement par crainte d’une jonction. Mais ça continue, ça s’est largement décloisonné. On en a conscience, parce qu’on participe à ce décloisonnement. Je n’étais pas pareille avant les gilets jaunes. Depuis, je passe mon temps à dire “mais si, il y a moyen de se battre ensemble !”. Et je vois que ça marche !
Nous aussi on a un travail à faire sur nos a priori. Par exemple sur le rapport au territoire : dans le cadre de mon travail, j’ai été amenée à me rendre souvent dans le Jura. J’y ai rencontré des gens qui ne voulaient pas d’un grand projet qualifié d’inutile. Le projet n’est pas passé, parce que les gens arrivaient à 400 aux réunions et ça a été politiquement très déterminant. Ils avaient un discours anti-mondialiste, sur l’oligarchie, etc. Et un discours sur la terre : “c’est notre terre, on ne veut pas en être dépossédé”. Finalement, c’est la même chose ici, on se bat pour défendre notre territoire, ne pas en être exclu, se le réapproprier. Je dois dire que c’était parfois un discours assez xénophobe également… Cela doit d’autant plus nous encourager à travailler sur notre rapport à la terre, comme enjeu commun, en vue d’en faire un bien commun. Tout est fait pour diviser la classe populaire. Il y a des divisions objectives, que produisent notamment les rapports raciaux de domination. Mais il y aussi des stratégies politiques de division : le projet de loi sur le séparatisme sert à ça. Ça doit au contraire nous pousser à agir encore plus pour s’unir.
Dans ton livre, tu dis “la classe populaire” et pas “les classes populaires”. Et tu ne choisis pas entre une “lecture raciale” et une « lecture question sociale”, comme dirait l’hebdomadaire Marianne, par exemple.
Alors, les gens qui interpellent à coups de “vous parlez de question raciale pour mettre de côté la question sociale”, je les connais bien. Ce sont des universitaires qui gagnent très bien leur vie – parlons concret, puisqu’on parle de classe -, des gens qui gagnent minimum 5000 euros par mois : des éditeurs, des éditorialistes de chez Marianne, justement… ils ont des salaires de bourgeois et prétendent nous faire la leçon sur la question sociale. Nous, on est serrés, on vit dans des quartiers, sales, et tu as un bourgeois qui vient te dire “il faut que tu parles de lutte des classes, il faut que tu parles de la question sociale”. C’est ridicule. En réalité, dès que tu leur rappelles leur salaire et leur appartement parisien, ils arrêtent de parler de question sociale parce que, vois-tu, c’est plus compliqué.
On a mené une lutte contre les ascenseurs en panne, c’était bien la question sociale. Mais on était seul(e)s. Personne n’est venu nous aider. Les communistes, qui dans le même temps nous accusaient de faire dans le communautarisme, ne sont pas du tout venus. Ça ne les intéressait pas. Parce qu’en réalité, au delà des discours pour disqualifier les militants des quartiers populaires, ça fait longtemps que la question sociale n’intéresse plus ces gens-là.
Cela étant dit, pour moi, la question centrale, ce n’est pas que la reconquête du territoire, c’est aussi la reconquête des moyens de production. La question centrale, c’est le travail. Mon père est ouvrier, et je vois bien que la discrimination et l’exploitation nous poursuivent, y compris sur des postes à responsabilité. Même dans les “nouveaux” secteurs dans les services, cette aliénation au travail et ces discriminations nous poursuivent. Par exemple le téléconseil. C’est pas l’usine. J’en ai fait longtemps, il y a quelques années. Et en réalité, si, le téléconseil, c’est l’usine : les numéros de commande et de livraison, j’en rêvais la nuit. Mais c’était pour continuer mes études, donc je tenais… Sur le plateau, il n’y avait que des femmes racisées, beaucoup de femmes voilées : on devait se faire appeler “Anne” ou “Dominique”. Donc pendant plusieurs heures, tous les jours, tu te fais appeler “Dominique” !
Les femmes qui portaient le foulard, il ne fallait pas qu’elles ouvrent leur bouche parce qu’impossible de trouver du travail ailleurs. Impossible de se syndiquer car c’est de l’intérim, donc tu peux prendre la porte chaque semaine. Dans cet exemple, la dimension de classe est importante. Quand tu es arabe, ce n’est pas la même chose d’être là que d’être fonctionnaire,. C’est pour ça que la stratégie de nos parents qui voulaient nous extraire de la classe populaire c’était un bon calcul. Comment tu veux faire respecter ta dignité quand toute la journée tu te fais appeler “Dominique” ? Je sais que j’ai laissé beaucoup de ma santé mentale pendant cette période. Et des gens que je connaissais à l’époque y sont toujours. Je ne me laisserai pas déposséder de la question sociale. Etant données mes conditions d’existence et celles de mon milieu, la dimension de classe fait partie intégrante des combats que je mène.
Le livre prend des allures de manifeste, pour un mouvement politique. Pour toi dans l’idéal, il faudrait faire quoi ?
Un ami m’a dit, sur le ton de la blague, “bon ,ok, mais c’est pas avec l’allaitement que tu vas faire la révolution”. C’est vrai, dans un sens. Dans notre imaginaire, être révolutionnaire, c’est prendre les armes, c’est des millions de personnes en colère. Et moi je parle de l’allaitement. Mais c’est parce qu’en réalité, de là où je parle, ce qui est révolutionnaire, c’est l’auto-organisation, c’est l’autonomie politique. Ce qui est révolutionnaire, c’est de gagner un peu de pouvoir dans la mesure où on en est totalement dépossédés. On continue, on ne va pas s’arrêter là, car la condition pour changer la société c’est bien sûr une organisation politique, ce qui demande du travail et du temps.
J’ai bien conscience qu’un projet politique doit recouvrir l’ensemble de ce qui fait société : il faut pouvoir réfléchir au système fiscal, à l’Union européenne, au système éducatif. La carte scolaire, par exemple, qu’est-ce qu’on en fait ? Et la TVA ? Que fait-on d’alternatif, concrètement? Selon moi, la dimension révolutionnaire du livre est d’abord liée au fait qu’il parle des mères, qui n’existaient pas en France politiquement, et surtout, qu’il fait des mères un sujet politique et stratégique capable de faire rupture avec le système actuel.
D’ailleurs, attention, ce n’est pas un sujet politique restrictif, c’est large. Organiser les mères, c’est organiser les quartiers populaires. On peut lire aussi le livre quand on n’est pas une mère ! Et en termes d’organisation politique, la suite c’est quel projet politique global on veut. Il faut pouvoir discuter de tout notre avenir politique, et ne pas être réduites et réduits à la décoration, à la question spécifique des quartiers. Pour moi, c’est le début de quelque chose. Le projet politique qu’on va pouvoir proposer, c’est un projet politique qui sera bien plus désirable que tous les programmes politiques des partis existants.
Pourquoi t’es-tu sentie si proche du mouvement des gilets jaunes ?
Parce que depuis 2015, il y avait tous ces bouquins et ces émissions sur les musulmans, sur les quartiers populaires, et une sorte d’annonce disant que les gens allaient se mobiliser contre les noirs et les arabes, les migrants, les femmes voilées, etc. Et quand on a vu, avec les gilets jaunes, que les gens se mobilisaient contre l’Etat, ses taxes, ses injustices et d’autres choses, on s’est vraiment dit “Dieu nous aime : on va avoir au moins cette parenthèse là pour souffler !” Et ça a été plus long qu’une petite parenthèse. Nous, on se reconnait dans les gilets jaunes. On savait que la classe populaire n’accepterait pas de payer pour cette écologie de classe, pour que la classe bourgeoise continue à polluer et détruire la planète pour maintenir ses profits. En tout cas, moi, j’espère que les gilets jaunes, ça va revenir.
PREMIERE PARTIE :
Rédaction