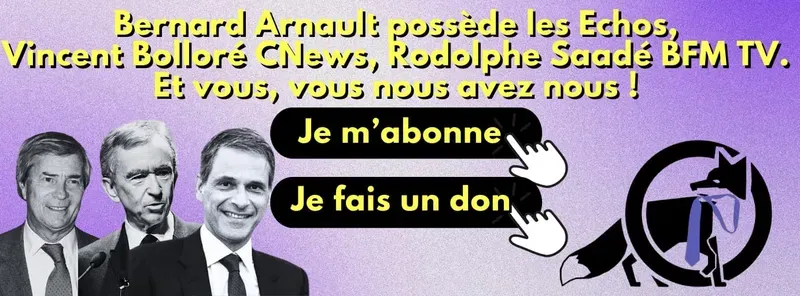Présidentielle américaine : comment expliquer la raclée démocrate ?

Quatre ans après avoir lancé ses partisans contre le Capitole, Donald Trump est de nouveau élu Président des États-Unis d’Amérique. He did it again, et cette fois la victoire est incontestable. 312 grands électeurs à 226, les sept Etats disputés (« swing states ») remportés avec 1 à 6 points d’écart, le vote populaire dans la poche (la première fois depuis 2004 et cinq élections pour les Républicains) et le contrôle des deux chambres du Congrès en prime. Trump augmente son nombre de voix depuis 2020 (de 3 millions) et progresse dans plus de neuf comtés sur dix à l’échelle du pays. Il enregistre des gains significatifs auprès des jeunes, des classes populaires, des Hispaniques, des Noirs, des femmes et des non-diplômés. Son mandat pour « make America great again » n’a jamais été aussi clair. Et la défaite d’un Parti démocrate qui aurait “abandonné les travailleurs” aussi cinglante. Anatomie d’une chute parfaitement évitable.
Sur le papier, les Démocrates pouvaient difficilement rêver d’un meilleur adversaire. Trump ne s’est pas contenté de tenter un putsch en direct à la télévision suite à sa défaite de 2020, ni de collectionner les condamnations en justice pour fraude et agression sexuelle aggravée. Pendant les dernières semaines de campagne, il a multiplié les outrances. En meeting, on a pu le voir mimer une fellation à l’aide de son micro, vanter la taille du pénis d’un golfeur professionnel, insulter un peu près tous les blocs électoraux du pays, expliquer qu’il « protégerait les femmes que ça leur plaise ou non » et menacer les Américains de confession juive de les tenir pour responsables en cas de défaite. Dans une émission où il était censé répondre aux questions du public, il a choisi de passer les quarante dernières minutes à se dandiner au son de sa playlist sans prononcer le moindre mot. Au risque d’aider Harris dans sa tentative de séduire les Républicains modérés, il a évoqué l’idée d’envoyer sa porte-parole Liz Cheney (une ex-républicaine) au peloton d’exécution, après avoir suggéré d’utiliser le carré de journaliste comme bouclier humain en cas de nouvelle tentative d’assassinat. Les démocrates ont fait de son extrémisme leur principal argument de campagne ? Pas de problème. Trump a exprimé son souhait d’envoyer l’armée s’occuper des « gauchistes » et de « l’ennemi intérieur » qualifié de « vermine ». Il a accusé les immigrés « d’empoisonner le sang de notre pays » pour justifier son projet d’expulsion de 20 millions d’entre eux. Il a suggéré à de multiples reprises qu’il refuserait de reconnaître sa défaite et qu’il utiliserait son mandat pour se venger de ses adversaires politiques.
Trump a exprimé son souhait d’envoyer l’armée s’occuper des « gauchistes » et de « l’ennemi intérieur » qualifié de « vermine ». Il a accusé les immigrés « d’empoisonner le sang de notre pays » pour justifier son projet d’expulsion de 20 millions d’entre eux.
Mais Trump a également tourné le dos à la rhétorique populiste qui avait fait le succès de sa première campagne. Il n’était plus question de mettre fin à la corruption de Washington en affirmant que personne ne pouvait l’acheter. Au contraire, il a mis en scène sa « bromance » avec Elon Musk, promettant d’aider ce dernier en échange de son soutien financier. Ses porte-parole ont même affirmé que son début de mandat serait « sanglant » et marquée par des coupes budgétaires « douloureuses, mais nécessaires » susceptibles de provoquer « une sévère récession ». Au cours de l’unique débat télévisé, il a reconnu n’avoir aucun projet précis pour résoudre le problème de l’assurance maladie, avant d’accuser Kamala Harris d’être favorable à une couverture santé à l’européenne, position qu’il défendait pourtant en 2015.
Au lieu de placer l’inflation et l’économie au centre de sa campagne, il a axé son discours sur l’insécurité, l’immigration et les paniques morales liées au « wokisme ». Ses propositions économiques se sont résumées à une baisse d’impôt pour les riches et les entreprises et de nouveaux droits de douane drastiques à la frontière. Pour le pouvoir d’achat, il a proposé la défiscalisation des pourboires et la déductibilité fiscale des intérêts des crédits automobiles. Sa victoire a été logiquement acclamée par Wall Street, la bourse prenant plus de 3 % et enrichissant au passage les dix plus grandes fortunes américaines de 64 milliards de dollars. Le même jour, ses conseillers informaient la presse que Trump allait “appliquer un programme pro-business fait de baisses d’impôts , de dérégulation et d’augmentation de la production pétrogazière” en garnissant son gouvernement de “milliardaires, anciens PDG, leaders de la Silicon Valley et des loyalistes”.
Un vote de classe en faveur du candidat des milliardaires
Si Kamala Harris était également soutenu par une cohorte de milliardaires et de nombreuses directions d’entreprises, Donald Trump a récolté deux à trois fois plus d’argent auprès des ultra-riches. Surtout, il a bénéficié du soutien du patronat américain et de ses principaux think tanks, là où Harris obtenait l’appui des principaux syndicats ouvriers du pays.
Et pourtant, pour la première fois, Trump a obtenu une majorité des voix auprès des électeurs gagnant moins de 50 000 dollars par an (50 % – 47 % , en hausse de 12 points par rapport à 2020) et 100 000 dollars par an (50-46 %)1. Contrairement à 2016 et 2020, le vote Trump est devenu un vote de classe. 80 % des électeurs plaçant l’économie en tête de leurs priorités ont voté pour lui. 78 % de ceux qui estiment que leur situation est « moins bonne qu’il y a quatre ans » (les deux tiers de l’électorat) et 70 % qui disent que l’inflation les affecte personnellement lui ont accordé leur vote. Et contrairement à 2016, Trump progresse spectaculairement auprès de ce qui devait représenter le cœur de l’électorat démocrate : les femmes (55% on voté Harris contre 60 % pour Biden en 2020), les jeunes de moins de 29 ans (Harris remporte ce groupe de 11 points, Biden l’avait remporté de 24 points) et les Latinos (65-32 pour Biden, seulement 52-46 pour Harris).

Ceux qui cherchent à mettre ce bouleversement sur le dos du wokisme devront expliquer pourquoi la circonscription qui a largement élu la très progressiste Alexandria Ocasio-Cortez a également été un des territoires ayant connu le plus large basculement de voix en faveur de Donald Trump. L’élue démocrate a demandé aux électeurs ayant voté pour elle et Trump de lui expliquer ce choix. Il ressort des réponses un phénomène que d’autres enquêtes ont mis à jour dans d’autres parties du pays : les électeurs interrogés estiment que Trump, comme Bernie Sanders et Ocasio-Cortez, est plus authentique et soucieux des travailleurs que le reste de la classe politique, tout en étant également perçu comme “extérieur” au système.
S’il est un peu tôt pour faire une analyse plus poussée de la sociologie du vote2, le revirement spectaculaire observé chez les Latinos, qui vient confirmer une tendance longue, interroge. D’autant plus qu’ils ne représentent pas un bloc unique : la troisième génération de Cubains vivant en Floride n’a pas beaucoup de choses en commun avec les Porto-Ricains de Pennsylvanie, ou les Vénézuéliens fraîchement arrivés au Texas. Une enquête passionnante livre des premières clés de compréhension : 80 % des Latinos appartiennent à la classe laborieuse. Les électeurs interrogés ne mentionnent pas les valeurs religieuses ou le wokisme pour justifier leur vote en faveur de Trump, mais le prix des œufs, les fins de mois difficiles et le fait qu’il incarne un changement.
It’s the economy, stupid !
L’économie a été le principal déterminant du vote, selon l’enquête post-électorale de l’Associated Press. En France, des commentateurs s’étonnaient du mécontentement américain sur ce sujet. Les États-Unis bénéficient d’un taux de croissance spectaculaire, le salaire moyen est deux fois plus élevé qu’en France, le taux de chômage est tombé en dessous de 4% et les salaires progressent, en partie grâce à la politique de Joe Biden et les luttes syndicales qu’il a appuyées. Ce dernier n’a-t-il pas fait beaucoup pour les travailleurs, que ce soit via sa politique fiscale, ses grands plans d’investissement ou en devenant le premier président américain à se rendre sur un piquet de grève ?
L’économie a été le principal déterminant du vote, selon l’enquête post-électorale de l’Associated Press.
Il faut aller vivre aux États-Unis et être confronté à la violence du système de santé hors de prix, à la grande précarité au travail, au coût prohibitif de l’éducation supérieure et des crèches, à l’explosion des loyers suite à la crise du logement et plus simplement aux inégalités spectaculaires pour interroger les indicateurs macro-économiques sur lesquelles bavent nos experts. Romaric Godin, journaliste à Médiapart, a fait un travail remarquable en analysant les données économiques plus fines (indices de consommation, évolution des salaires chez les non-cadres, coût des biens et services essentiels, espérance de vie) pour arriver à un constat simple et évident : la reprise économique post-covid n’a pas bénéficié aux travailleurs américains.
À l’inflation s’est ajoutée la politique contra-cyclique de la FED (la banque centrale américaine). L’augmentation des taux d’intérêt a exacerbé la crise du logement, attisé l’impression de déclassement en rendant les prêts immobiliers et crédits automobiles inaccessibles, sans pour autant réduire l’inflation. Le président de la FED avait reconnu que sa politique n’allait pas faire baisser le prix de l’énergie ou des denrées alimentaires. Il s’agissait, une fois de plus, d’une politique de classe. La hausse des taux devant permettre de protéger les patrimoines, quitte à détériorer le marché de l’emploi. Une approche tacitement soutenue par Joe Biden, qui a obstinément refusé de critiquer la FED, contre l’avis de ses propres conseillers.
La reprise économique post-covid n’a pas bénéficié aux travailleurs américains.
Le Financial Times relevait qu’à travers le monde et ses dernières années, les gouvernements sortants ont subi des revers électoraux majeurs. Si on met de côté les succès de la gauche radicale mexicaine, la victoire de Trump s’inscrirait dans une double tendance : la montée de l’extrême droite et le rejet des partis au pouvoir. Un discours mis en avant pour éviter de critiquer les orientations politiques prises par le Parti démocrate.
Du néolibéralisme à l’abandon des classes laborieuses : l’implosion d’une stratégie mûrement réfléchie
Le recul démocrate auprès de la classe ouvrière ne date pas d’hier. Le Parti de Roosevelt paye le tournant néolibéral entamé par Carter, les traités de libre-échange imposés par l’administration Clinton et la politique austéritaire d’Obama. Confronté à la crise des subprimes de 2008, ce dernier avait sauvé les banques en facilitant l’éviction de 10 millions de familles de leurs logements.
Le Parti démocrate estimait que son recul auprès des classes ouvrières blanches serait compensé par ses gains chez les diplômés. Chuck Schumer, le président du groupe au Sénat et numéro 3 du Parti, avait théorisé cette ligne. En 2016, il expliquait que “pour chaque ouvrier que nous perdons dans les comtés ruraux de Pennsylvanie, on gagnera deux Républicains modérés dans les banlieues aisées de Philadelphie. Et on peut répéter cela en Ohio, Illinois et au Wisconsin”.
Le Parti démocrate estimait que son recul auprès des classes ouvrières blanches serait compensé par ses gains chez les diplômés.
Le vote des minorités (dont le poids démographique progresse) étant considéré comme acquis du fait du racisme affiché par le Parti républicain, les Démocrates s’imaginaient en situation d’hégémonie perpétuelle.
À leur décharge, la droite américaine souscrivait à cette grille d’analyse. Suite à la réélection d’Obama contre un multimillionnaire ayant fait fortune dans la vente à la découpe des entreprises, le Parti républicain évoquait dans un rapport stratégique interne la nécessité d’être un parti “plus inclusif” et soucieux des minorités. En parallèle, entre 2008 et 2016, il s’est livré à un effort concerté et discret pour compliquer l’accès au vote des minorités ethniques tout en pratiquant un redécoupage des circonscriptions électorales sur des lignes raciales, dans le but d’obtenir un avantage structurel au Congrès. Une approche balayée par l’arrivée du trumpisme, qui a fait voler en éclat ces grilles de lecture.
“Après avoir abandonné les classes ouvrières, le Parti démocrate ne doit pas s’étonner d’être à son tour abandonné par elles. Il a d’abord perdu la classe ouvrière blanche, et maintenant les classes laborieuses noires et les Hispaniques”
Bernie Sanders, chef de file de l’aile gauche du parti démocrate
Bernie Sanders a résumé le nouveau paradigme dans un communiqué cinglant, publié le lendemain de la défaite d’Harris. Dès les premières lignes, le chef de file de la gauche radicale estime qu’“après avoir abandonné les classes ouvrières, le Parti démocrate ne doit pas s’étonner d’être à son tour abandonné par elles. Il a d’abord perdu la classe ouvrière blanche, et maintenant les classes laborieuses noires et les Hispaniques”. Sanders avait tenté d’inverser la tendance avec ses campagnes présidentielles de 2016 et 2020, méthodiquement écrasées par les élites démocrates.
Joe Biden, coupable idéal ?
Poussé par son aile gauche, Joe Biden a tenté de remédier à l’érosion du vote des classes laborieuses en instaurant certaines mesures portées par la gauche radicale américaine tout en adoptant une rhétorique populiste et prosyndicale inspirée de Bernie Sanders. Mais les programmes les plus ambitieux et populaires qu’il a mis en place avaient tous une date d’expiration plus ou moins proche de l’élection. Pour l’américain peu politisé, celui qui a arrêté son choix dans les dernières semaines de la campagne 2024, Biden est le président qui a mis fin au moratoire sur les expulsions de logements, retiré la couverture santé publique Medicaid à 25 millions de personnes, suspendu le programme d’allocation familiale voté par le Congrès en début de mandat, durcit les conditions d’accès à l’aide alimentaire et mis un terme au moratoire sur le remboursement des prêts étudiants (en octobre 2024, soit quelques semaines avant l’élection !). À l’inverse, les retombées de son plan d’investissement pour la transition énergétique ou la mise en place de plafond pour le prix d’une dizaine de médicaments ne prendront réellement effets qu’en 2025…
Biden est le président qui a mis fin au moratoire sur les expulsions de logements, retiré la couverture santé publique Medicaid à 25 millions de personnes, suspendu le programme d’allocation familiale voté par le congrès en début de mandat, durci les conditions d’accès à l’aide alimentaire et mis un terme au moratoire sur le remboursement des prêts étudiants.
Accusant son âge avancé, son manque de charisme grandissant et son attachement maladif à la bienséance protocolaire, Joe Biden n’a pas su ou voulu utiliser le mégaphone conféré par la présidence pour combattre ces perceptions, imposer un narratif fort et tenir un discours de classe efficace. Il a laissé s’installer l’idée que sa politique de relance économique post-covid avait provoqué l’inflation (dont il niait par ailleurs la réalité). Or, cette idée est fausse : l’Europe a connu une inflation similaire malgré une politique de relance budgétaire bien plus timide. De plus, les données de la FED montrent que le regain de consommation post-covid n’a pas excédé les tendances précovid. L’essentiel de l’inflation découle de la guerre en Ukraine et de l’accroissement des marges des entreprises profitant de leur situation monopolistique, comme l’ont reconnu la FED et la BCE.
Un dirigeant compétent et peu soucieux de se mettre à dos la grande bourgeoisie américaine aurait martelé nuit et jour que l’inflation était provoquée par les multinationales et leurs patrons. Pas Joe Biden, dont l’entêtement à briguer un second mandat a rendu son camp complice d’un mensonge évident sur son état de santé. Il aura fallu un débat télévisé désastreux pour que les cadres du Parti finissent par l’obliger à renoncer. En partant, Biden a fait un cadeau empoisonné aux Démocrates : au lieu d’appeler à une convention ouverte pour choisir son remplaçant via un processus démocratique, comme le suggérait Obama, il a imposé Kamala Harris. Soit la pire option après lui.
Kamala Harris : une campagne très à droite et une candidate (presque) aussi incompétente que Joe Biden
“Kamala Harris a mené une campagne parfaite” pouvait-on entendre sur les plateaux télévisés. Si elle a échoué, c’est parce qu’elle aurait hérité d’une tâche insurmontable, compliquée par la gauche radicale. Pour éviter toute remise en question, les élites démocrates et leurs relais médiatiques ont rapidement mis leur défaite sur le dos de la gauche américaine, dont les torts ne se limiteraient pas au “wokisme”. Elle aurait contraint Joe Biden a mené des politiques inflationnistes et Kamala Harris à prendre des positions trop radicales lors des primaires démocrates de 2019. Par opportunisme, elle s’était alors déclarée en faveur de la socialisation de l’assurance maladie proposée par Bernie Sanders et du “Green New Deal” porté par Alexandria Ocasio-Cortez. Incapable d’expliquer pourquoi elle avait changé d’avis sur ces questions, Harris risquait de passer pour une arriviste. Ces faiblesses étaient connues, comme le fait que Joe Biden lui avait mis un énorme boulet au pied en la nommant responsable de la gestion de la crise migratoire à la frontière mexicaine dès son début de mandat, en 2021. Ça n’a pas empêché le Parti de se rallier derrière sa candidature.
Pour éviter toute remise en question, les élites démocrates et leurs relais médiatiques ont rapidement mis leur défaite sur le dos de la gauche américaine.
Au désespoir de la Maison-Blanche, la candidate démocrate a abandonné les propositions les plus ambitieuses portées par Joe Biden et entamé un virage à droite. Comme le rapportait le New York Times, “Harris a un discours économique approuvé par Wall Street” dont les dirigeants se félicitaient d’avoir “modéré son programme” construit à partir “des conseils de ses alliés de Wall Street et de la Silicon Valley”. Son beau-frère, dirigeant d’Uber (sic), l’a convaincue d’abandonner la rhétorique populiste et de cesser de dénoncer les intérêts financiers.
L’accent a été mis sur le danger représenté par Donald Trump pour la démocratie américaine et les droits des femmes. Harris s’est vantée d’avoir obtenu le soutien de Dick Cheney (Vice-président de Georges W. Bush, architecte de la guerre en Irak et du programme de torture à Guantanamo) et à fait de sa fille Liz Cheney, ancienne élue du Parti républicain, sa porte-parole dans le Midwest. L’autre figure élevée au rang de porte-parolat ne fut autre que le milliardaire Mark Cuban. La première a incarné la rhétorique guerrière et le soutien inconditionnel à Israël manifesté avec obstination par Kamala Harris, malgré les alertes de ses propres équipes sur l’impact négatif que cela aurait sur le vote musulman et étudiant. Le second a véhiculé un discours propatronal pour minimiser la radicalité du programme de Kamala Harris. Pire, interrogée sur ce qu’elle aurait fait différemment de Joe Biden, Harris a répondu “il n’y a rien qui me vient à l’esprit, j’ai été associée à toutes les décisions importantes”.
“Harris a un discours économique approuvé par Wall Street.”
The New York Times
Ses modestes propositions pour résoudre la crise du logement sont symptomatiques : au lieu de défendre l’encadrement des loyers, une mesure populaire avancée par son colistier et ses alliés, elle a proposé une aide financière aux primo-acquérants. De même, l’assurance maladie était absente de sa campagne, une première pour un candidat démocrate.
Sur l’immigration et la sécurité, Harris a tenté de mettre en avant sa carrière de procureur pour tenir un discours de fermeté susceptible de concurrencer Trump sur ce terrain. De même, lors du débat télévisé, elle a expliqué posséder une arme à feu, défendu la fracturation hydraulique, s’est vantée du record de production pétrolière atteint par les États-Unis sous la présidence Biden et à promis d’inclure un Républicain au sein de son gouvernement. Tout cela devait permettre de séduire les républicains allergiques à Donald Trump et les électeurs modérés.
Comme Clinton en 2016, Harris a fait campagne à droite et perdu.
Le résultat parle de lui-même : 5 % des électeurs s’identifiant comme Républicains ont voté pour Harris, contre 6 % pour Biden en 2020. Comme Clinton en 2016, Harris a fait campagne à droite et perdu.
Outre ses prises de position, Harris n’a pas réussi à ancrer sa campagne dans le moindre récit clivant. Celui de Trump était clair : le pays va à la dérive et votre qualité de vie baisse à cause des immigrants qui nous envahissent et des élites côtières atteintes de wokisme. Bernie Sanders offrait une alternative convaincante : ce n’est pas la faute des immigrés, mais des milliardaires et des multinationales. Et la solution passe par des mesures redistributives qui vont leur déplaire. Harris n’avait rien d’autre à offrir que des platitudes censées froisser le moins de monde possible.

Pour de nombreux Américains, le discours sur la démocratie en danger était inaudible. Outre le fait que cette préoccupation était éloignée de leur quotidien, sa crédibilité était remise en cause par le comportement de son propre camp, qui a masqué pendant des mois le déclin cognitif manifeste de Joe Biden. Si le pays se trouvait au bord du fascisme, les démocrates auraient été inspirés de sélectionner dès le départ un candidat capable de lire un prompteur.
Ensuite, la “démocratie” de Harris ne fonctionne que pour une minorité d’Américains, comme l’a reconnu avec une lucidité rafraîchissante l’ancien conseiller d’Obama Ben Rhodes dans une tribune au New York Times. Pour de nombreux Américains, l’attaque contre le Capitole n’était pas uniquement un déchainement de violence, mais une réponse quelque peu méritée contre le lieu où se concentre la corruption légalisée d’un système à sens unique.
Pour de nombreux Américains, le discours sur la démocratie en danger était inaudible.
Tout journaliste couvrant le Congrès sait pertinemment que c’est derrière ses murs qu’une armée de lobbyistes surpayés transforme en une bouillie insipide les rares propositions de lois dont l’objet n’est pas de servir les intérêts des classes supérieures. Dans la dernière enquête du Times avant les élections, 19 % des électeurs estimaient que le principal risque pesant sur la démocratie américaine était le niveau de corruption (21 % citaient Trump). Un résultat qui conforte de nombreuses autres enquêtes montrant qu’une majorité de l’électorat considère “les États-Unis comme une oligarchie, plus une démocratie”.
Au lieu de parler à ces électeurs, Harris a mené la campagne la plus chère de l’Histoire, dépensant un milliard de dollars, dont plusieurs dizaines de millions pour s’offrir les prestations de stars du show-biz. Enrichissant au passage une classe de consultants et de professionnels de la politique totalement déconnectés des réalités du pays.
Contrairement au récit dominant, l’Amérique ne vire pas à droite
Si Trump a incontestablement gagné l’élection, il ne remporte que 49,5 % des voix et obtient une des plus faibles marges de victoire de l’Histoire. Le Parti démocrate limite la casse au Sénat (un tiers des sièges, majoritairement détenus par les Démocrates, étaient en jeu) et conserverait le même nombre d’élus à la Chambre des représentants du Congrès. Les Américains devaient également voter pour certains élus et référendums locaux. Ceux qui visaient à protéger le droit à l’avortement ont systématiquement obtenu de meilleurs scores que Kamala Harris et été victorieux dans l’écrasante majorité des cas. Le Missouri a voté en faveur d’une hausse du salaire minimum de 20 % et des arrêts maladie payés. De même, les candidats démocrates au Sénat ont systématiquement obtenu de meilleurs résultats qu’Harris (de plus de 3 % en moyenne). Le gouverneur de Caroline du Nord et les sénateurs de trois des quatre “swing states” en jeu ont remporté l’élection, alors qu’Harris avait été distancée par Trump. Parfois parce que les électeurs ont voté Trump sans voter pour le candidat républicain, parfois parce qu’ils ont voté pour Trump et le candidat démocrate. Cela inclut aussi bien des gouverneurs et sénateurs plutôt centristes et des élus issus de la gauche radicale, comme les musulmanes Ilhan Omar et Rashida Tlaib.
Enfin, Harris fait mieux dans les “swing states” que dans les États où elle n’a pas fait campagne. Dans le premier cas, des groupes affiliés à sa campagne ont matraqué les ondes avec des spots publicitaires déployant une rhétorique de classe. On pouvait y trouver des arguments pointant la corruption de Donald Trump et sa promesse de servir ses amis milliardaires, présentés en opposition des quelques mesures sociales portées par Harris. Les milliers de militants déployés sur ces territoires et les millions de tracts envoyés par courrier mettaient également l’accent sur les questions économiques, comme les syndicalistes mobilisés pour Harris dans le cœur industriel de la Rust Belt. Dans le reste du pays, les électeurs n’ont été exposés qu’au message central de Harris portant sur l’extrémisme de Trump.
Ces éléments montrent à quel point Kamala Harris a mené une mauvaise campagne. Mais ils remettent également en cause la notion de droitisation de l’électorat. Trump a gagné sans la majorité absolue des voix. Les électeurs voulaient du changement. Harris défendait des améliorations à la marge sur le plan économique et une reconduction de la politique étrangère impopulaire de l’administration sortante. Trump incarnait la seule alternative aux années Biden. Et toutes les enquêtes d’opinion montrent que les propositions portées par l’aile gauche démocrate sont majoritaires dans l’opinion.
Faire campagne sur ce type de programme en suivant les conseils de Bernie Sanders n’aurait peut-être pas suffi à mobiliser les quelques centaines de milliers d’électeurs qui ont manqué à Kamala Harris et avaient voté Biden en 2020, car la candidate démocrate manque de crédibilité pour porter un tel message. Mais répéter la stratégie désastreuse d’Hillary Clinton ne pouvait que produire une humiliation similaire. Les Démocrates vont devoir se remettre en question, ce qui n’est ni dans l’intérêt de leurs donateurs ni dans ceux de l’armée de consultants qui a dilapidé le milliard de dollars de fonds récoltés par la campagne. D’où cette lutte pour construire des discours alternatifs susceptibles d’expliquer la défaite. Discours répétés par la majorité de la bourgeoisie française, pour ses propres intérêts.
- Les données électorales proviennent du sondage réalisé en sortie des urnes par un consortium de médias américains (CNN, ABC News, FoxNews) sur 23000 électeurs. ↩︎
- Le “voter file”, une enquête bien plus fournie portant sur 120 00 électeurs sera publiée dans les trois mois suivant l’élection par un organisme indépendant, comme c’est l’usage après chaque élection. Ces données donneront une meilleure compréhension du vote, comparées aux sondages réalisés en sortie des urnes.
↩︎
Christophe est l’auteur de Les Illusions perdues de l’Amérique démocrate (Vendémiaire, 2021). On peut le suivre via sa newsletter ici, et sur Twitter : @PoliticoboyTX
Photo de couverture : Kamala Harris en janvier 2024, Crédit photo : The White House, Public domain, via Wikimedia Commons
Nous avons atteint plusieurs limites de notre modèle économique et nous risquons de ne plus pouvoir continuer sans un coup de pouce de nos lectrices et lecteurs.

À LIRE AUSSI :