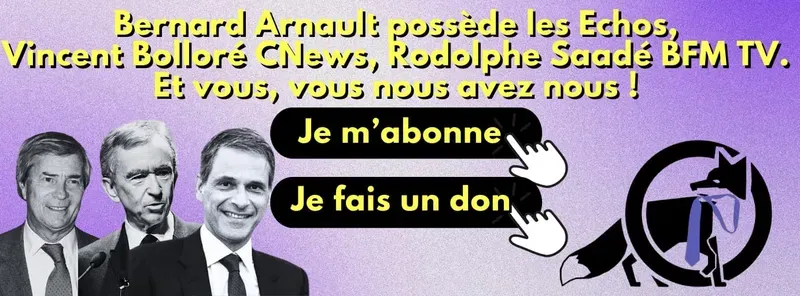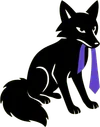Comment réussir sa grève de la performance ? – Sabotage au travail (1/2)

Depuis quelques mois, les grands médias s’emballent autour d’une tendance selon eux inquiétante et dangereuse : le « quiet quitting », ou « démission silencieuse », se serait emparé de nombre de travailleurs dans le monde, qui s’impliqueraient moins dans leur travail voire, comble de l’horreur, s’en tiendraient strictement aux horaires définis sur leur contrat de travail. « Apparu sur TikTok, le #quietquitting prend de plus en plus d’ampleur et dépasse désormais les 65 millions de vues. Que révèle cette tendance ? » s’interroge le Figaro. Quant au Monde, on sait vers qui va son empathie, lui qui titre : « Les DRH confrontés au phénomène insidieux du « quiet quitting ». Cette tendance s’inscrit pourtant dans une tradition plus que centenaire, longtemps promue par le mouvement ouvrier et tombée en déshérence, au profit de formes de résistance plus instituées comme la grève ou, nettement moins efficace, le « dialogue social » entre « partenaires sociaux ». Pourtant, la résistance à la performance au travail, au dépassement de soi, aux heures supplémentaires, voire à l’enthousiasme forcé que les managers aiment nous voir adopter, est très efficace, et permet de réduire l’exploitation au travail, de retrouver sa dignité face à l’arbitraire patronal voire de trouver la force d’aller plus loin : le sabotage au travail, ou une façon possible de reprendre le pouvoir sur son travail et, à terme, de changer la société.
« Mes responsables ce ne sont pas mes responsables, ce sont les responsables de l’organisation du travail. Moi, je fais ce que je veux : on ne me donne pas d’ordres, en fait, on me donne des tâches. Et on ne me les donne pas, on me les demande ! ». Du haut de ses 135 000 abonnés sur Tik Tok, Zak donne ses conseils pour ne plus être soumis et déprimé au travail. Lui qui se définit dans sa bio comme une « Bad bitch à temps plein » multiplie les vidéos, à la demande de ses followers, pour conseiller de prendre un arrêt maladie quand ça ne va pas, comment se comporter avec ses chefs, comment se faire respecter. « Sache que moi aussi avant j’étais une moutonne Marine » répondait-il, il y a quelques semaines à une follower. Et de raconter comment, pendant des mois, il s’est donné à fond pour son boulot de vendeur, sans réussir à obtenir le moindre changement d’horaire (il faisait les fermetures tous les jours et n’en pouvait plus). C’est en cessant de faire du zèle et en multipliant les arrêts maladies qu’il a fini par obtenir ce qu’il voulait. « Quand on travaille comme des esclaves vous dites tout le temps non, mais quand on vous fait chier vous dites oui ! »
Il n’est pas le seul à parler de son travail sur Tik Tok. Selon les journalistes effrayés par le “quiet quitting”, ce mot d’ordre serait venu du réseau social et toucherait donc son public, les moins de trente ans. Pour ma part, je suis désormais spammé par ces vidéos-là, en alternance avec des tutos musculation (“tu veux avoir des abdos de rêve ? Alors suis mes 3 conseils !”) et des recettes de cuisine. Elles sont arrivées peu après la découverte d’un livre, un classique du mouvement ouvrier depuis tombé en déshérence : le Sabotage, par Emile Pouget.
Le sabotage, un outil de lutte oublié
Emile Pouget était un secrétaire général de la CGT au début du siècle passé. À l’époque, la CGT avait une orientation anarcho-syndicaliste : elle prônait la grève comme moyen d’instaurer un rapport de force avec le patronat pour obtenir une amélioration de la condition des travailleurs, comme la journée de 8 h, mais aussi pour aller vers une révolution sociale. Mais la grève n’était pas le seul mode d’action encouragé par la CGT. Le sabotage en faisait également partie.

Comme le montre Victor Cachard dans son Histoire du sabotage, l’imaginaire actuel du sabotage repose davantage sur son usage militaire, notamment durant la résistance aux nazis. Quand on pense sabotage, on pense destruction de voie de chemin de fer, explosion de bombes, etc. Mais à l’origine, le terme avait une signification plus accessible à n’importe quel travailleur : il s’agissait de travailler plus lentement, de ralentir le rythme, de ne faire que le nécessaire. Mais cela pouvait aller plus loin : Émile Pouget évoque plusieurs exemples de travailleurs qui ont enrayé la production en détournant ou abîmant leurs outils : les coiffeurs de Paris, entre 1903 et 1906, ont mis en œuvre des campagnes de “badigeonnage” des boutiques, c’est-à-dire de dépôt d’un shampoing amélioré par leurs soins (avec des œufs) sur les devantures, pour finir par obtenir un jour de fermeture et de repos hebdomadaire. Ou encore les boulangers dont l’un des modes d’action était de s’en prendre aux pétrins ou bien de réaliser du pain dur et immangeable…
« Quand on travaille comme des esclaves vous dites tout le temps non, mais quand on vous fait chier vous dites oui ! »
Pour Pouget, le sabotage consistait ni plus ni moins à affirmer une morale de classe : ne pas se tuer à la tâche pour un patron, ne pas se laisser exploiter en faisant le dos rond, ne pas travailler plus que ce pour quoi je suis payé. Pour Pouget, la morale du travail “est à l’usage exclusif des prolétaires, les riches qui la prônent n’ayant garde de s’y soumettre : l’oisiveté n’est vice que chez les pauvres. C’est au nom de cette morale spéciale que les ouvriers doivent trimer dur et sans rêve au profit de leurs patrons et que tout relâchement de leur part, dans l’effort de production, tout ce qui tend à réduire le bénéfice escompté par l’employeur, est qualifié d’action immorale.” Saboter, c’est-à-dire au moins traîner des pieds au travail, au mieux empêcher la production en s’en prenant aux outils et à la bonne organisation du travail, est une façon de contrecarrer cette morale de classe, pour en affirmer une autre : ne pas être soumis au patronat et faire du zèle.
L’injonction au surtravail s’est imposée partout
Or, le sabotage au sens le plus ordinaire du terme, c’est-à-dire ne pas surtravailler, est terriblement d’actualité. En effet, la morale dénoncée par Pouget il y a plus d’un siècle s’est imposée dans toutes les entreprises et imprègne notre société. Les récents débats sur la “valeur travail”, invoquée à droite comme à gauche, le montrent, mais pas seulement : dans nombre d’organisations, le surtravail fait partie du fonctionnement normal de la structure. Le zèle n’est pas un petit plus, c’est une exigence de base que les employeurs formulent et contrôlent. De nombreuses stratégies managériales existent pour obtenir des salariés qu’ils donnent le maximum, bien au-delà de ce qui est écrit sur leur contrat de travail. La fixation d’objectif, par exemple, se fait de plus en plus à l’excès. Pour obtenir une prime, il faut désormais “sur-performer”, c’est-à-dire dépasser à la fois ses collègues et ses résultats précédents.
Dans l’entreprise Soap&Stuff*, qui possède de très nombreuses marques que l’on trouve dans la grande distribution, les commerciaux et les salariés chargés d’aménager les présentoirs, opérations promotionnelles et de s’assurer que les produits sont toujours bien en vus, sont évalués sur leurs résultats, mais aussi, désormais, sur leur comportement : ils doivent être toujours positifs et ne faire que des critiques constructives (“une critique suivie d’une proposition positive”, m’explique le DRH lors d’une mission d’expertise dans cette entreprise). Certaines entreprises vont plus loin dans l’incitation au surtravail : elles jouent sur la nécessaire convivialité, celle des “afterworks” et des week-ends d’intégration, et veulent stimuler “l’engagement” des “collaborateurs”.
Comme si nous n’étions là que pour être une bande de potes travaillant ensemble à un objectif commun qui ne serait pas la rémunération des actionnaires ou, dans le secteur public, la prochaine promotion du Polytechnicien qui dirige notre entreprise ou politicien qui tient notre agence ou notre ministère.
C’est quelque chose que j’ai toujours trouvé fascinant dans les différents postes que j’ai occupés : chacun met un point d’honneur à avoir l’air surbooké tout le temps, que cela soit réellement le cas ou non.
Certains secteurs sont particulièrement touchés par le phénomène de surtravail et d’injonction à surperformer, pour d’autres raisons : dans l’associatif, chaque salarié est incité à donner le meilleur de lui-même, car les budgets sont limités et la cause noble. Ainsi, pourquoi compter ses heures quand on participe à une action artistique, humanitaire ou politique ? Nos politiques sont les premiers partisans du surtravail de leurs propres collaborateurs parlementaires : à l’Assemblée nationale, l’application du droit du travail reste inexistante et le travail de soir, de nuit ou du week-end est monnaie courante. Salarié dans cette vénérable institution, j’ai fait des semaines de 50 h et du travail nocturne (pour assister mes députés dans le débat parlementaire) pour un contrat à… 39 h. Autant dire que même celles et ceux qui défendent ordinairement les conditions de travail des gens (quand il s’agit de députés de gauche) sont les moins bien lotis et les moins respectueux des conditions de travail.
La surperformance au travail s’est donc imposée partout, qu’elle soit nécessaire ou non. C’est quelque chose que j’ai toujours trouvé fascinant dans les différents postes que j’ai occupés : chacun met un point d’honneur à avoir l’air surbooké tout le temps, que cela soit réellement le cas ou non. On connaît bien sûr le cas du collègue qui ne fait pas grand-chose le matin, mais part tard le soir, mettant en scène, sous sa lampe de bureau, son impérative présence nocturne. Il y a celles et ceux qui s’affairent constamment, sans raison apparente. Et il y a les petits chefs que cette ambiance studieuse et fiévreuse rassure. Frédéric*, manager dans une entreprise de consulting informatique, me racontait comment il avait été contraint d’assister à une formation intitulée “comment créer un sentiment d’urgence” pour améliorer les performances de son équipe. C’est donc ça !

Il faut toujours en faire plus au travail, non pour des raisons d’efficacité, mais, le plus souvent, pour des raisons morales : un bon travailleur du capitalisme est un travailleur qui en fait plus qu’il ne devrait. C’est quelqu’un de “perfectionniste”, ce fameux défaut que nous nous préparons tous à citer dans un entretien d’embauche, cette passion à l’ouvrage que nous déclarons tous dans nos lettres de motivation qui est, soit dit en passant, un exercice complètement inutile mais qui a pour intérêt de nous conduire à renouveler, à chaque nouvelle candidature, une déclaration préalable de soumission pour espérer obtenir une déclaration préalable d’embauche.
La grève de la performance : faire son travail, ni plus ni moins
Pour autant, la résistance s’organise, et le mot d’ordre de sabotage façon traîne-savate, que j’appellerais “grève de la performance”, se diffuse sur les réseaux sociaux et dans les discussions les plus quotidiennes. Même lorsque l’on est isolé face au monde du travail, nous finissons tous par percevoir que, le plus souvent, le surtravail ne paie pas. Nous n’obtenons ni reconnaissance, ni augmentation, à travailler plus fort. Au contraire : très rapidement, ce zèle est perçu comme une norme, une chose que l’on peut attendre de nous en permanence. En surtravaillant, nous réduisons la valeur et le prix de notre travail.
Sophie* a passé des années à se surinvestir dans son travail “pour du vent et des pâtes sans beurre à la fin du mois, une propulsion à un rôle de management parce que c’était arrangeant pour la direction de ne pas recruter en externe quelqu’un de compétent et qualifié (et donc cher), sans formation ni préparation, des heures supplémentaires par centaines non payées, etc.”. Sa décision de se mettre au ralenti au travail a été prise assez rapidement : “Je suis partie en vacances – des vraies comme je n’avais pas vraiment eu/pu avoir depuis des années. Je suis revenue avec une prise de recul et un adage personnel « ce n’est qu’un job, la terre ne s’arrêtera pas de tourner sans toi. » Du coup, j’ai arrêté les heures supp gratos, j’ai arrêté d’en avoir quelque chose à faire, d’y mettre du cœur. J’ai fait mon travail – celui pour lequel je n’étais pas cher payée – mais ni plus ni moins. En moins d’un mois, le résultat s’est fait sentir positivement pour moi, j’ai arrêté d’être dépendante émotionnellement d’un travail toxique.”
“Je fais juste mon travail, rien de plus” : cette attitude finalement logique et cohérente déplaît fortement aux strates managériales qui attendent toujours ce surcroît de travail qui baisse le prix du salarié… Sophie a été convoquée par sa direction, qui n’a rien su répondre à sa posture de cohérence avec son propre contrat de travail.
“Le plus souvent, je consulte des pages internet ou je lis des fichiers PDF ou je fais des petits projets informatiques persos. Aujourd’hui, sur mes 8 heures de présence au bureau, je n’ai travaillé que 3 heures pour mon patron.”
Laurent* est salarié dans une entreprise informatique. Désormais, il assume clairement en faire le moins possible, et sa vie au travail est parfaitement organisée dans ce sens : “Parfois, sur mes heures de travail salariées, je travaille en perruque en prenant une tâche sur l’une des nombreuses plateformes de micro-jobs en ligne. D’autres fois, je travaille en perruque bénévolement pour le site web d’une association qui me tient à cœur. Le plus souvent, je consulte des pages internet ou je lis des fichiers PDF ou je fais des petits projets informatiques persos. Aujourd’hui, sur mes 8 heures de présence au bureau, je n’ai travaillé que 3 heures pour mon patron.” Le moins que l’on puisse dire, c’est que Laurent a drastiquement réduit l’exploitation au travail : en travaillant moins pour son patron et plus pour lui, il a repartagé la valeur créée ! Le temps qu’il n’accorde plus à son travail, il le consacre à travailler “en perruque”. Ce terme, issu de l’argot ouvrier, désigne le détournement de son travail à des fins personnelles : utiliser les matériaux et les machines de l’entreprise pour son propre usage ou celui d’une autre structure militante, associative, lucrative… En m’apprenant ce mot, Laurent m’a fait prendre conscience que Frustration magazine a été, durant des années, réalisé en perruque : sur nos heures de travail, en utilisant les ordinateurs, les imprimantes, les enveloppes de nos jobs mal payés et ennuyeux.
Laurent est-il un flemmard, une sorte de Gaston Lagaffe, ce personnage de bande-dessinée traîne-savate et bricoleur, cauchemar de tout manager control freak ? Pas vraiment. “Ça fait 8 ans que j’occupe mon poste. J’ai essayé de m’y investir durant les 3 premières années. Finalement, j’ai compris que mes idées ne seraient jamais prises en compte par mon chef. Pour éviter la frustration professionnelle, j’ai alors cessé de m’intéresser à la marche de l’entreprise où je travaille.” Quel est le secret de Laurent pour parvenir à un tel détachement ? Une bonne éducation : “Je n’ai pas mauvaise conscience, en partie parce que c’est un héritage : quand j’étais jeune adolescent, j’ai été une fois voir le bureau où travaillait mon père. Il m’a montré dans un placard de superbes enceintes Wifi : il écoutait de la musique classique pendant ses heures de travail.”
La grève de la performance ne constitue que l’une des modalités possibles du sabotage au travail. D’autres moyens existent pour résister, retrouver sa dignité et reprendre le pouvoir sur son travail. A retrouver dans la suite de cette enquête, juste ici :
Nicolas Framont

Rédaction