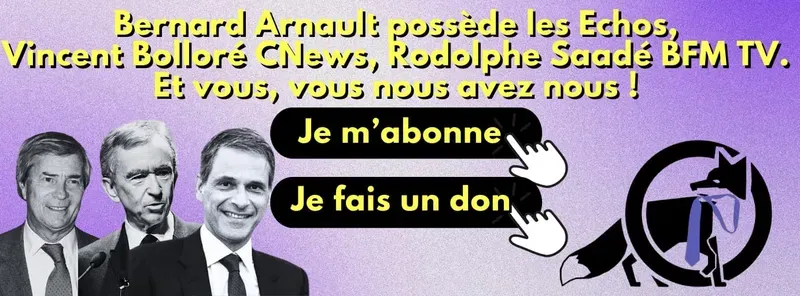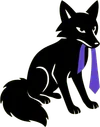Du jogging de cité au bleu d’ouvrier, avoir la classe est une affaire de classe
Il vous est déjà peut-être arrivé, au cours de votre été, de croiser de jeunes cadres dynamiques à la barbe bien taillée porter des bleus de travail d’ouvriers BTP, version chics et raffinés. Le “bleu”, ce vêtement de travail d’une seule pièce, composé d’une veste et d’un pantalon réunis et qui peut être de différentes couleurs, que l’on identifie visuellement le plus souvent en bleu, comme son nom l’indique. On en trouve le plus souvent dans certains quartiers gentrifiés (processus par lequel la population d’un quartier populaire fait place à une classe plus aisée en important aussi son mode de vie et de consommation) de grandes villes à boire des spritz en terrasse telles que Paris, Lyon ou encore Bordeaux. Moi-même je me suis surpris à penser intérieurement, un demi quart de seconde (à peine) : “han, pas mal du tout, ces bleus !”. Peu de temps après avoir pris la mesure dramatique de cette pensée honteuse et refoulée, le bleu est devenu comme une obsession, j’ai commencé à en voir de plus en plus autour de moi, à chaque coin de rue : partout, tout le temps.
La marque française Soubacq fabrique des bleus de travail haute couture : “Chaque semaine, Louise, la fondatrice, déniche les étoffes des grandes maisons de mode pour vous confectionner, au cœur de Paris, un Bleu en série très limitée.” 205 euros le bleu de travail, c’est très limite, pour une tenue portée initialement par des ouvriers payés une misère…
De l’ouvrier BTP au fashionista, il n’y a qu’un pas
“En 1904, une jeune fille de bonne famille, Mademoiselle Soubacq, s’éprend d’un bel ouvrier, et découvre ainsi un nouveau monde. Un monde en bleu de travail qu’elle fait sien, en ajustant, en reprenant, en prenant soin de cet uniforme des travailleurs. Mademoiselle Soubacq finit par se l’approprier en y brodant son nom.” Lorsque l’on consulte leur site web, rubrique “Notre Histoire”, l’appropriation culturelle et symbolique de la bourgeoise sur le prolo y est étonnamment assumée, et rendue légitime grâce à une petite histoire romantique digne de la belle et le clodo.
Et ils ne sont évidemment pas les seuls sur ce marché florissant. La célèbre marque Agnès B surfe également sur cette hype ouvrière, mais également Jean-Paul Gaultier qui à l’occasion de son dernier défilé après 50 ans de carrière, portait un tee-shirt marin et une combinaison bleu de travail “parce que je suis un travailleur, un artisan”, confie t-il à Paris Match. Tellement travailleur qu’il est le couturier-patron le mieux payé cette année, sa fortune s’établissant en millions d’euros. Un authentique premier de cordée. On me rétorquera que Gaultier lui-même est originaire d’un monde populaire et ouvrier. Oui. Gérald Darmanin également.
Timothée, 32 ans et cadre dans le secteur de l’énergie, ne quitte que rarement son bleu de travail dans sa vie de tous les jours. Il peste contre cette récupération marketing par de grandes marques de mode qui les vendent à des prix outranciers : “Quand je vois des marques qui surfent sur la tendance et vendent des bleus de travail à plus de 100 balles, je trouve ça aberrant. Le principe même d’un bleu c’est le côté vintage, se dire qu’il a appartenu à quelqu’un, qu’on lui donne une seconde vie. En acheter un neuf c’est une infamie. C’est donc aberrant que des marques haut de gamme surfent sur cette tendance et sortent dans leur collection des bleus de travail tout neufs, pas du tout vintage, avec une empreinte carbone pas top, et en plus à un prix colossal, alors que les fripes débordent de bleus de travail d’occasion”.

Vendre des bleus de travail d’occasion en friperie est justement l’activité quasi quotidienne de Kriss. Brocanteur depuis quatre ans, cela fait un an qu’il s’est spécialisé dans le vêtement de travail vintage des années 60 et 70. Il me confie que c’est un milieu de plus en plus difficile car évoluant dans un marché mondial, impulsé notamment au Japon, et hautement concurrentiel : “C’est tellement à la mode que certains font que ça !”. Je l’ai retrouvé à l’une des ventes qu’il organise certains samedis à Belleville (un quartier parisien initialement populaire en cours de gentrification aujourd’hui), au bar “Les Folies”.
Installés en terrasse, il me raconte l’histoire d’un vêtement démocratisé à la fin du XIXe siècle dans les milieux ouvriers français qui symboliserait la révolution industrielle (période qui nous a fait basculer une société à dominante agraire et artisanale vers une société commerciale et industrielle) et la multiplication d’usines françaises nouvelles implantées sur tout le territoire. La couleur bleue (dit “indigo” ou “bleu violet”, bon marché à l’époque) de la veste représente la classe ouvrière et permet de se différencier des vestes de chefs et patrons souvent grises ou blanches et beaucoup moins robustes, même s’il existe différentes couleurs de bleus de travail, notamment aujourd’hui.
Pour Kriss, le principal intérêt d’un tel vêtement est sa matière, appelée moleskine. Plutôt que de trouer le tissu et de brûler son propriétaire, elle permet aux morceaux de métal en fusion de glisser sur cette matière, protégeant ainsi les ouvriers au travail. Cela en fait un habit robuste et pratique dont sa couleur attrayante, au bel effet délavé, est rendue possible à force d’être lavé depuis de nombreuses années. “Cela fait deux ans et demi que j’en porte. Je voyais pas mal de bleus de travail chez mes amis scandinaves, et j’ai décidé de m’en acheter un à mon tour. Je suis allé chez Guerrisol (ndlr : friperie parisienne) et en cinq minutes, c’était réglé”, me précise le jeune cadre Timothée, grand amateur de bleu.
Le bleu de travail, vêtement déculpabilisateur pour sous-bourgeois branché ?
Attaché(e)s de presse, salarié(e)s de start-up innovantes, journalistes, professions dans le marketing digital… En moyenne, les consommateurs de bleus de travail comme objet de mode rencontrés ou croisés sont pour l’essentiel des sous-bourgeois (courroie de transmission entre la bourgeoisie, ceux qui possèdent, et la classe laborieuse, ceux qui travaillent, que nous avons défini ici) urbains qui vivent dans des quartiers qu’ils gentrifient eux-mêmes : à Paris, dans des quartiers comme Belleville ou Ménilmontant, mais également dans des villes telles que Bordeaux ou Nantes. C’est d’ailleurs ce que Kriss le brocanteur me confirme : “L’essentiel de mes consommateurs restent quand même des bobos urbains et trentenaires”. Alexandre et Eloïse, âgés de 28 ans et qui travaillent dans le secteur de l’art et de la communication, l’illustrent à merveille. Croisés au détour d’une rue près de Ménilmontant (quartier parisien particulièrement représentatif de cette sociologie de CSP+ urbains), ils trouvent cet habit “beau”, “élégant”, et dont la “bonne matière” les aura convaincus de s’y mettre, après avoir constaté cette mode se répandre comme une traînée de poudre autour d’eux il y a encore quelques mois. Ils reconnaissent que cela peut paraître un brin “étonnant”, mais que “ça permet de redonner vie à des vêtements du passé et donc de leur rendre hommage à notre manière”, justifient-ils.
Ce sont des vêtements ouvriers portés par des bobos trentenaires dans les métiers du digital et qui sont la plupart du temps en télétravail.
Kriss, vendeur de bleu de travail
Pour Kriss, ce discours peut sembler faussement naïf, même s’ils n’en ont pas forcément conscience. Car ces sous-bourgeois porteraient des bleus de travail aussi pour se “déculpabiliser”, un vêtement d’héritage ouvrier dans un quartier initialement populaire comme l’est Belleville mais qu’ils gentrifient, au détriment des classes laborieuses condamnées à vivre loin des centres villes. “Ils sont dans une totale contradiction pour la plupart », ironise Kriss, qui connaît particulièrement bien ce quartier pour y avoir vécu longtemps et observé son embourgeoisement progressif, commun à de nombreuses villes de France, “et ça leur donne l’impression d’être intégrés, d’une certaine manière. Ce sont des vêtements ouvriers de travail portés par des bobos trentenaires dans les métiers du digital et qui sont la plupart du temps en télétravail”. L’utilisation contradictoire du bleu de travail looké chez les sous-bourgeois illustre bien leur position sociale “d’entre deux” : une catégorie de courroie de transmission entre les classes laborieuses et la bourgeoisie mal à l’aise entre un rôle social plutôt confortable en contradiction avec certains de leurs idéaux plus ou moins égalitaires ou de justice sociale.

Chic ou de frip, est-ce indécent de porter un bleu de travail ? “Ma grand-mère me dirait qu’elle n’avait pas envie de revoir des bleus de travail que portait mon grand-père dans la maison, ça lui rappellerait le travail et les souffrances endurées”, avoue Kriss. J’ai demandé son avis à José, le père d’une amie. Il travaille dans le secteur des travaux publics depuis 35 ans, toujours vêtu de son bleu de travail. Il n’était pas “du tout au courant” que l’on porte ce type de vêtement de travail dans le quotidien et ça le fait doucement rigoler, “plus rien ne m’étonne de nos jours !”, sans pour autant le “choquer outre mesure”.
Quand la bourgeoisie récupère un vêtement de prolo, celui-ci devient élégant et cool, comme par magie
“Les conditions déplorables de travail d’antan ne sont pas le fait d’un vêtement, mais du système capitaliste, il n’y a donc pas de paradoxe à trouver un vêtement beau même si des gens ont souffert à l’intérieur. Sinon on ne mettrait pas de jean, qui était au départ un produit pour les mineurs de fond, ni de trench-coat qui était pour les militaires… Et non, pas d’hommage ou de symbolique ouvrière, pour ma part. Ce serait quand même bien présomptueux de porter une fringue que l’on aime en faisant croire qu’on essaye de faire passer un message social. Mais hommage d’un monde industriel passé, d’un vêtement fait en France avant la mondialisation, ça oui !”, argumente Timothée. Des propos qui participent au mythe d’une classe ouvrière qui aurait quasiment disparu de nos jours, ce qui est complètement faux puisque les ouvriers sont encore plus nombreux que les cadres et représentent tout de même 20% de la population active. Quant à l’idée d’un vêtement issu d’un “monde industriel passé”, elle va bien vite en besogne : de nombreux ouvriers du BTP sur les chantiers portent évidemment encore aujourd’hui des bleus de travail (plutôt de couleur grise en règle générale, me précise une connaissance dans ce secteur), ou encore dans la plupart des garages de notre pays. Même si les conditions de travail ont évolué depuis le XIXe siècle, elles restent difficiles aujourd’hui, avec de nombreux blessés ou morts d’accident du travail répertoriés chaque semaine, et les dévastatrices lois travail 1 et 2 socialistes qui ont une nouvelle fois fait reculer le droit des travailleurs. Mais la remarque de Timothée n’en est pas moins pertinente. On ne mettrait peut-être pas de jean aujourd’hui, par exemple, si l’on raisonnait uniquement sous ce prisme…
Dans l’histoire de la mode, des vêtements de travail issus de la classe laborieuse qui deviennent de nouvelles tendances vestimentaires n’a rien de nouveau. Le jean était initialement utilisé par des bûcherons et il est aujourd’hui totalement démocratisé grâce à son tissu connu pour sa résistance. On peut citer également le bob de pêcheur, utilisé dans les années 90 et 80 par des rappeurs aux États-Unis et que l’on a pu voir apparaître cet été sur de nombreuses têtes branchées (oui, les parisiens en vacances cet été à Marseille, on parle de vous). Le pragmatisme et l’aspect utilitaire d’un vêtement ne viendrait-il pas à l’origine de fringues issues et portées initialement par la classe laborieuse ?
C’est une fois que la mode du jogging a été récupérée par la bourgeoisie que l’établissement l’a finalement autorisé.
Julie, ex surveillante dans un internat de la reussite
Demandons-nous surtout : pourquoi doit-on attendre de la bourgeoisie ou sous-bourgeoisie qu’elles posent délicatement leurs mains sur des fringues prolétaires pour les rendre cools, attrayantes et portables dans la vie de tous les jours ? Ont t-elles le pouvoir de gentrifier des vêtements par son simple touché porté par la grâce d’Anna Wintour ou de Cristina Cordula ?
Prenons l’exemple du jogging. Porté essentiellement par des jeunes de cité au quotidien (j’ai pu moi-même en porter la moitié du collège et en classe de seconde, avant de me mettre… aux slims, oui oui), le magazine féminin Marie-Claire nous informe qu’il devient à la “mode”, que nous pouvons aisément traduire par : “ne devient plus ce vêtement beauf d’arabe qui stationne sur les marches d’un immeuble”, à partir de 2016, lors du défilé Chloé printemps-été : “Edie Campbell foule le podium dans un survêtement d’inflexion rétro, façon René Lacoste meets Wes Anderson”. Et d’autres stars branchées, comme la chanteuse à succès américaine Selena Gomez, emboîtent le pas.

Julie* était surveillante dans un internat réputé appelé “de la réussite”, où des élèves des quartiers populaires sont placés dans des beaux quartiers, pendant un an. “Quand l’internat s’est installé, le voisinage bourgeois a vu l’arrivée de ces jeunes d’un mauvais œil. Pour qu’il y ait donc une meilleure allure, ils ont interdit les joggings. Ce n’était pas officiel mais tout le monde l’a remarqué. Ils ont réinstauré depuis l’an dernier les joggings car tout le monde en met maintenant, notamment les enfants de Neuilly sur seine ! C’est une fois que la mode du jogging a été récupérée par la bourgeoisie que l’établissement l’a finalement autorisé. Ils ont justifié le rétablissement au motif qu’avec l’EPS ce n’est pas pratique car certains élèves ne peuvent pas se changer, mais personne n’y croyait.”
La marque de luxe Balenciaga vient également de sortir un sac Tati Barbès à carreaux, comme ceux du “bled”, pour la somme de 1500 euros, tandis que le magasin Tati de Barbès, connu entre autres pour ses prix attractifs, fermera ses portes pour être remplacé par un hôtel (et d’autres choses du genre). Indépendamment des 1500 euros un poil excessif, voici un énième exemple du fait que dès que la bourgeoisie pose la main sur un sac initialement jugé beauf et sans goût, il se transforme en or, comme par magie : c’est ça, avoir le monopole bourgeois du (bon) goût.
Mais il peut aussi y avoir des allers retours dans la mode. Au début, la marque Lacoste était utilisée par des personnes âgées relativement conservatrices, qui ont tiré la gueule quand ils ont vu que tout le monde portait leur polo dans les banlieues françaises. Tandis qu’aujourd’hui, leurs égéries sont des rappeurs très populaires qui font la Une des Inrocks, comme le raconte très bien la journaliste Célia Sadaï dans Africultures en juillet 2020 (qui évoque dans son texte également l’engouement bourgeois pour des baskets Lidle) :”Un jour, quelqu’un m’a dit : « – Quand un Arabe conduit une smart, c’est qu’elle n’est plus à la mode. » Ça m’a fait penser au Polo Lacoste. Dans les années 90, le polo Lacoste était très à la mode chez les jeunes racisés. On appelait ça « un kosla ». Moi, j’en avais acheté un faux à un vendeur ambulant, pour 10 francs, sous le pont du périphérique à l’entrée des Puces de Clignancourt. Le petit crocodile, il était hyper sémiotique à nos yeux. Il signifiait qu’on avait beau être pauvres, on avait la classe. Il signifiait aussi qu’on appartenait à la culture hip-hop, puisque Lacoste était une des marques fétiches de nos rappeurs préférés. Bref, on avait resémantisé le crocodile en petit logo communautaire. Je me souviens que la marque s’en était plainte, nous accusant d’être à l’origine d’une baisse des ventes (sans compter que pour la plupart d’entre nous, nous portions des imitations). Pour Lacoste, nous dégradions leur image de marque : la bourgeoisie blanche férue de tennis ne voulait évidemment pas nous ressembler. C’était dans les années 90, tout ça. Ensuite il y a eu les années 2010. Et avec son retard habituel de 20 ans, la bourgeoisie blanche s’est emparée de la culture hip-hop, déclaré jusqu’alors “sous-culture de cailleras”. Et la marque Lacoste a choisi pour égérie le (très beau) rappeur Moha La Squale (ndlr : depuis septembre 2020, le chanteur est accusé d’agressions sexuelles et la marque a ainsi cessé la collaboration. L’article de Célia Sadaï a été publié avant ces accusations) C’est ça, l’histoire de l’Arabe qui conduit une Smart. Il y aura toujours un moment où l’on achètera une Smart parce que c’est un Arabe qui la conduit.”

Le gilet jaune que vous apercevez en arrière plan ne sera malheureusement pas à la mode tant que Selena Gomez ne l’aura pas porté dans un aéorport avec des lunettes de soleil.
Malgré l’utilisation d’un même vêtement par bourgeois et laborieux, rien n’y fait : chacun reste toujours à sa classe.
En d’autres termes, bourgeoisie et sous-bourgeoisie, en particulier blanche ici, récupèrent ces vêtements, les rendent par leur classe sociale dominante “portable” en société, et cela en devient naturellement une nouvelle distinction sociale… vis-à-vis de la classe laborieuse, chez qui porter un jogging est encore perçu comme un marqueur social péjoratif et excluant. Malgré l’utilisation d’un même vêtement par bourgeois et laborieux, rien n’y fait : chacun reste toujours à sa classe.
Les bourgeois puis les sous-bourgeois qui les portent adorent détourner les choses de leur usage initial. C’est ça qui est « cool », d’où l’attrait pour les objets culturels de banlieue, comme le jogging ou le sac Barbès. Avoir le choix de s’approprier une culture qui sera jamais vraiment la nôtre pour être un peu stylé, avoir le luxe de jouer de tous les registres, en ayant l’assurance de ne jamais en subir les stigmates… Je me demande si la tenue de mon père, brancardier depuis plus de trente ans, sera un jour elle aussi à la mode dans plusieurs années et sa matière appréciée pour ce qu’elle est. Peut-être devrais-je déjà penser à en mettre une ou deux de côté, qui sait. “La mode se démode, le style jamais”, disait Coco Chanel. La classe laborieuse aurait-elle le monopole du style et la bourgeoisie d’une mode qui se démode afin d’alimenter en permanence sa soif de renouveau, de coolitude et de décalage qui lui fait oublier, le temps d’un achat, la permanence et l’injustice de sa domination sociale ?
Selim Derkaoui
* Le prénom a été modifié.
Rédaction