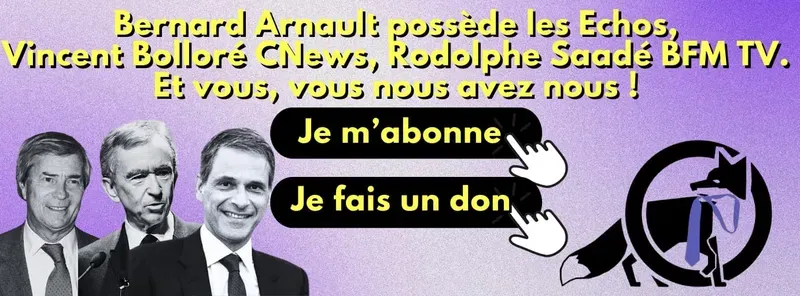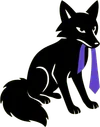« Le livre des solutions » : Gondry et l’idéologie du génie toxique

Le livre des solutions est le dernier film en date du réalisateur français Michel Gondry. Il raconte les étapes qui précèdent la sortie d’un film loufoque et avant-gardiste réalisé par un cinéaste, Marc Becker, incarné à l’écran par Pierre Niney. Son équipe et lui se sont refugiés chez la grand-tante du cinéaste, dans un village des Cévennes, pour échapper à des producteurs tatillons. Le film raconte ce travail mené à plusieurs mais sous la houlette d’un réalisateur génie incompris, victime de troubles bipolaires, par ailleurs tyrannique, harceleur moral et égocentrique. Le film a été encensé par la critique : Les Cahiers du Cinéma ont adoré, l’Humanité trouve qu’il est d’une “profondeur rare”, tandis que Télérama, futé, trouve qu’”il y a beaucoup de l’ingénieux Michel Gondry chez le cinéaste ultra inventif joué par Pierre Niney.”
Effectivement, c’est bien de lui dont Michel Gondry parle, comme le souligne l’Obs avec enthousiasme : le personnage de Pierre Niney serait un “alter ego savoureux de Gondry.” La réception critique de ce film en dit finalement très long sur la façon dont est envisagé le cinéma parmi la classe dominante du secteur culturel en France : comme un processus violent comprenant de l’exploitation d’autrui, des cris, des décisions insensées pour un résultat qui sera célébré, à la fin, comme l’oeuvre d’un “génie”.
Le harcèlement au travail est le principal ressort “comique” du film. Gondry compte nous embarquer par le rire dans la banalisation et la justification de la violence au travail, ce qui a des chances de fonctionner en raison du jeu d’acteur et de la bouille sympathique de Pierre Niney.
Le livre des solutions campe un personnage qui, durant tout le film, et de façon particulièrement éprouvante quand on a un minimum d’empathie, hurle sur son équipe. Il donne des ordres incohérents, change d’idées en permanence, réveille ses collaboratrices la nuit et les regarde dormir jusqu’à ce qu’elles fassent, dans la minute, ce qu’il exige… Ce harcèlement au travail est le principal ressort “comique” du film. Gondry compte nous embarquer par le rire dans la banalisation et la justification de la violence au travail, ce qui a des chances de fonctionner en raison du jeu d’acteur et de la bouille sympathique de Pierre Niney.
Les premières scènes laissent pourtant espérer autre chose : la monteuse, Charlotte, incarnée par Blanche Gardin, affiche un flegme blasé et une certaine autorité face à son patron. Son assistante et secrétaire, Sylvia, jouée par Frankie Wallach, semble également habituée aux lubies de son boss et se moque gentiment de lui. Mais, à mesure que le film avance, la violence du patron prend le dessus sur les actes de résistances, de plus en plus inefficaces. La scène où Sylvia craque, en larmes, face à un patron qui continue de lui crier dessus, est particulièrement violente.
Une représentation trompeuse des troubles bipolaires
Mais face à cette tyrannie, toute désapprobation du spectateur est désarmée par avance : en effet, dans les 10 premières minutes, nous avons tous vu Marc Becker jeter ses médicaments dans les toilettes. Cette scène ultra lourde, très illustrative, est ensuite accompagnée pendant tout le film de moments de psychose. La réalité de sa maladie est accréditée par l’attitude résiliente et empathique de la vieille tante, qui n’est là que pour rappeler que son petit neveu est d’abord un homme qui souffre. Si elle remet régulièrement son protégé à sa place, le poussant à s’excuser pour ses coups de sang (ce qu’il ne fait généralement pas, ou sans conviction aucune), son unique rôle dans le film est de lui redonner une humanité et de couvrir ainsi sa violence.
Le fait que tous les personnages excusent les comportements de Marc Becker du fait de sa maladie donne à ce trouble réel une dimension qu’il n’a pas et contribue au passage à caricaturer cette maladie encore trop mal comprise, et souvent stigmatisée.
La mise en avant de la maladie psychique du héros, qui s’apparente à un trouble bipolaire, également appelé psychose maniaco-dépressive et qui se manifeste par de brusques changements d’humeur, d’un enthousiasme démesuré à une immense tristesse, est particulièrement trompeuse. Car la bipolarité n’implique pas nécessairement la violence physique et verbale et la manipulation des autres. Le fait que tous les personnages excusent les comportements de Marc Becker du fait de sa maladie donne à ce trouble réel une dimension qu’il n’a pas et contribue au passage à caricaturer cette maladie encore trop mal comprise, et souvent stigmatisée.
Des personnages féminins faire-valoir du héros
La grand-tante empathique n’est pas le seul personnage féminin qui remplit cette fonction classique de soin au héros tourmenté. Conceptualisé par la réalisatrice Laura Mulvey en 1975, le “male gaze”, ou “regard masculin”, est une grille de lecture qui permet d’analyser un film sous l’angle de la place secondaire et sexiste qu’il réserve aux femmes. Michel Gondry saute des deux pieds dans ce travers en créant un personnage, Gabrielle (incarnée par Camille Rutherford), dont l’unique fonction est de servir de muse, de faire-valoir au personnage tourmenté et capricieux de Marc Becker. Belle, douce et n’ayant aucune existence propre, c’est elle qui va sauver le réalisateur de la dépression et l’aider à se reprendre en main après qu’il ait fait craquer psychologiquement toute son équipe. Elle n’est qu’une béquille émotionnelle, on ne saura ni ce qu’elle fait comme métier, ni ce qu’elle aime dans le vie, elle est la pièce manquante au personnage principal, comme un nombre incalculable de rôles féminins au cinéma.
En cela, le personnage de Marc Becker est le prototype du génie encensé par l’idéologie bourgeoise du talent qui excuse tout. Selon cette idéologie, Picasso, homme ultra violent et manipulateur envers les femmes, comme Roman Polanski, qui est accusé d’avoir violé plusieurs femmes dont une enfant de 13 ans ou comme Bertrand Cantat, qui a tabassé à mort Marie Trintignant, sa violence n’est que le corollaire de son génie, ou en tout cas n’en retire rien. Les génies sont des gens dont le talent a une dimension extraordinaire, inexplicable et surtout très précieuse pour la société : il ne faudrait surtout pas que leur attitude à l’égard des autres, et en particulier les femmes, aussi atroce soit-elle, ne vienne changer le culte que nous leur louons. Il est à cet égard perturbant de voire Blanche Gardin, une actrice qui avait taclé, en 2017, la rhétorique consistant à dire qu’il fallait toujours “séparer l’homme de l’artiste” incarner le rôle de la supplétive qui enchaîne les humiliations, les chantages et les caprices d’un génie incompris sans lui en vouloir le moins du monde.
Contrairement à ce que les critiques enthousiastes prétendent, à aucun moment ce film ne nous apprend comment on fait du grand cinéma. Il nous montre seulement à quel point un grand cinéaste a le droit de se comporter comme un gros con.
(Attention spoiler:) Les derniers plans du film nous montrent un public conquis, enthousiaste et admiratif devant la première du film de Marc Becker, dont à aucun moment on ne saura précisément quelle idée géniale de mise en scène, de jeu d’acteur ou de montage aura transformé les extraits incompréhensibles qui ponctuent le film en chef d’oeuvre. Seule la création de la bande originale, que Marc Becker compose lui-même après avoir humilié et viré un chef d’orchestre devant toute sa troupe, nous est réellement montrée. Contrairement à ce que les critiques enthousiastes prétendent, à aucun moment ce film ne nous apprend comment on fait du grand cinéma. Il nous montre seulement à quel point un grand cinéaste a le droit de se comporter comme un gros con.
Une brillante contribution aux mythes bourgeois du génie
Le film de Michel Gondry s’inscrit dans l’idéologie plus large, extrêmement contemporaine et bourgeoise, du génie. Cette idéologie comporte plusieurs grands mythes.
Premier mythe : le génie se serait fait tout seul. Il serait le méritant par excellence. Il ne devrait son mérite à rien d’autre qu’à des caractéristiques quasi-surnaturelles, qui n’auraient – ça alors – aucun lien avec son milieu social. C’est sans doute pour appuyer ce trait – fictif – que Gondry fait provenir son alter égo d’un petit village des Cévennes alors que lui-même a grandi à Versailles, dans une famille de musiciens connus. Pour Samah Karaki, une neuroscientifique qui a consacré cette année un livre au mythe du talent, : « Les génies ne sont jamais solitaires, même si on aime les imaginer comme étant des êtres marginaux qui, comme ça, par dérive psychanalytique, en ayant vécu des traumas dans l’enfance, dans l’adolescence, ont pu dériver et finalement fournir une innovation sociale. En fait, si on creuse, que ce soit dans les sciences ou dans les arts, le génie solitaire n’existe pas parce qu’il s’assoit sur un écosystème. C’est une excroissance d’un écosystème qui est déjà présent, de connaissances, de travail, de collaboration, de contributions qui sont très complexes, qui font qu’un individu va comme un petit nain qui s’assoit sur l’épaule d’un géant de connaissances et de collaboration nous paraître comme étant celui ou celle qui a produit cette innovation. »
Cette analyse nous amène au deuxième grand mythe, que l’on retrouve dans le film : les chefs d’œuvres des génies le seraient globalement de leur seul fait. Car si le film de Gondry met en scène une équipe, ses membres sont dépourvus de la moindre possibilité d’initiative, leur boss les mettant constamment dans un climat de confusion et de peur qui les empêche d’accomplir correctement leur travail. Le film met en scène un réalisateur omnipotent, capable d’avoir un avis sur tous les aspects du film, du scénario à la bande originale, alors que ce n’est jamais ce qu’il se produit. A cet égard, mon ami D., à qui je disais, en sortant du film, que cette daube signée Gondry risquait de changer à tout jamais l’image que j’avais de l’une des oeuvres les plus connues, Eternal Sunshine of the Spotless Mind (qui est l’un de mes films préférés), m’a rappelé que ce chef d’oeuvre avait été écrit par le scénariste Charlie Kaufman. Sa bande originale si remarquable est marquée par des compositions de Jon Brion tandis qu’on imagine désormais la grande équipe que Gondry a du martyriser pendant le film et qui a été ensuite invisibilisée par son grand nom. Il n’est pas le seul à maîtriser cette tradition bien nocive : alors que le succès d’un film est toujours le fait d’un très vaste groupe de gens, c’est toujours le nom du réalisateur qui écrase tous les autres.
« Que ce soit dans les sciences ou dans les arts, le génie solitaire n’existe pas parce qu’il s’assoit sur un écosystème. C’est une excroissance d’un écosystème qui est déjà présent, de connaissances, de travail, de collaboration, de contributions qui sont très complexes. »
Samah Karaki
Le troisième mythe se situe dans l’idée déjà illustrée plus haut qu’on ne fait pas de génie sans casser d’œufs, et qu’un grand génie vaut bien de petits tracas. Harcèlement moral, souffrance au travail, violences psychologiques ou sexuelles : rien ne saurait ternir l’image qu’on devrait avoir des génies, qui sont de toute façon “incompris” et ne méritent pas d’être jugés comme le commun des mortels.
Avec ce film, Michel Gondry ne s’offre pas seulement un égotrip plaisant pour lui. Il demande aux spectateurs de venir avec lui entériner les grands axes de l’idéologie du génie, celle qui justifie ses sales comportements potentiels, l’invisibilisation des autres et l’idée d’une réussite qui n’aurait dépendu que de son propre talent. Que les critiques de cinéma qui appartiennent ou envient l’univers culturel de la classe dominante s’y laissent prendre n’a rien de surprenant. A nous de nous désintoxiquer de ce genre de discours, car nous ne sommes plus dupes.
Nicolas Framont


Nicolas Framont
Rédacteur en chef